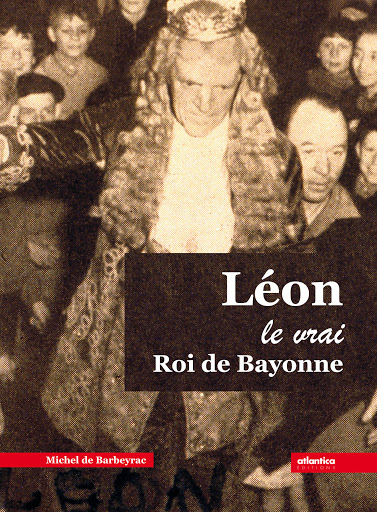Pourquoi les bergers landais utilisaient-ils des échasses ?
C’est toujours l’image d’Épinal des Landes : un berger dressé sur ses échasses, revêtu d’une peau de mouton, auprès de son troupeau. Si les échassiers ont disparu au 19e siècle, le folklore permet de ne pas oublier la culture pastorale landaise, un peu particulière.
Olivier Sorondo – 2 octobre 2021 – Dernière MAJ : le 28 mars 2022 à 15 h 03 min

Une origine incertaine
La documentation historique s’avère insuffisante pour dater avec précision l’apparition des échasses dans les Landes et expliquer leur provenance, si provenance il y a.
Certaines sources pointent vers les Flandres, où les échasses étaient utilisées dès le 12e siècle. Elles auraient été importées par des voyageurs puis progressivement adaptées, car les Flamands les tenaient par les mains, sans fixation au-dessous du genou.
On retrouve même la présence des échasses à des temps encore plus lointains. En Grèce antique, elles servaient aux danses rituelles et aux rites initiatiques. Pour leur part, les Romains y avaient recours lors des représentations théâtrales.
Plus globalement, les échasses ont été adoptées par de très nombreux pays, du Sri Lanka (chez les pêcheurs) au Togo (lors des évènements festifs).
En France, il faut attendre le début du 18e siècle pour voir apparaître les premières mentions des échassiers landais dans la littérature, dont l’ouvrage « Mémoire sur la généralité de Guyenne », rédigé par l’intendant de Bordeaux en 1714.
En 1726, un certain G. Mamier constate « des vachers qui gardent les bestiaux, montés sur des échasses de 3 ou 4 pieds de haut. » Cinquante ans plus tard, le comte de Guibert, de l’Académie française, remarque leur utilisation dans la région de Dax.
Des échasses, mais pour quoi faire ?
Avant leur transformation radicale, décidée par l’empereur Napoléon III, les Landes de Gascogne se composent de grandes étendues d’herbes, de broussailles et de hautes brandes. Le sol est pauvre, sableux, peu propice aux cultures. En revanche, le territoire se révèle particulièrement adapté à l’élevage des moutons et des chèvres.
C’est dans cet environnement que les échasses montrent toute leur efficacité. Juché de 3 à 5 pieds au-dessus du sol, le berger peut surveiller plus facilement son troupeau, généralement constitué de 100 à 150 têtes. Le loup n’est jamais loin.
L’homme peut également se déplacer rapidement malgré la difficulté des sols, éviter les piqûres d’ajoncs, omniprésents, et protéger ses pieds des terrains humides et de la boue. Contrairement à une croyance bien ancrée, les échasses ne servent pas à traverser les marécages (au risque de s’enfoncer), mais plutôt à les repérer afin de les éviter.

Les échasses sont constituées de deux pièces. C’est d’abord « l’escaça », qui signifie « jambe » en gascon, dont la longueur varie entre 90 cm et 1,20 m, et ensuite le « paousse pé » (ou « repose pied »). Elles sont fixées autour de la jambe, juste sous le genou, par une lanière en cuir, bien serrée. Enfin, les embouts sont renforcés de clous.
Le berger peut ainsi profiter de ses mains libres pour vaquer à différentes activités ou tenir son long bâton, sur lequel il s’appuie pour surveiller le troupeau.
Le berger, cet être solitaire
Le géographe Louis Papy apporte quelques précisions sur le berger landais dans son texte « L’ancienne vie pastorale dans la Grande Lande », publié en 1947 dans la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest : « Le pâtre de la Grande Lande est spécialisé dans l’élevage des moutons. Un propriétaire l’a engagé pour un an. Il a la charge de faire paître et de soigner son troupeau. Sa rétribution comportera quelque argent, quelques boisseaux de seigle et de millet, quelques cents de sardines, du sel, une toison. »
Tout au long du 18e siècle, la lande accueillera ce personnage devenu emblématique. Vêtu d’une prisse faite de peau de mouton et d’un béret de laine vissé sur la tête, il parcourt de vastes territoires, accompagné d’un ou deux chiens.
La population locale le considère un peu comme un sorcier, du fait de sa solitude au cœur d’une nature parfois hostile. L’homme vit chichement. Ses repas frugaux se composent de bouillies, de lard, de sardines, de pain frotté d’ail. Il les agrémente parfois du fruit de la chasse.
Lorsque la journée est paisible, ses activités consistent à filer la laine de ses bêtes ou à jouer de petits airs de musique à l’aide de sa tchalemine, une sorte de hautbois rudimentaire.
Ses périples lointains l’amènent de temps en temps à croiser d’autres bergers, avec qui il partage l’oustalet, une petite maison située au milieu de nulle part dans le cœur de la grande lande. Les foires et les fêtes représentent les seules opportunités d’échanges avec les habitants des villages environnants.
Le berger est un nomade, loin de toute vie sociale, parfait connaisseur de son environnement infini.
Une disparition inéluctable
Sous le Second Empire, l’ingénieur Chambrelent s’attaque à l’infertilité des sols de la grande lande. Il observe que l’imperméabilité du sous-sol, née de l’agglutination du sable par les sucs végétaux, rend les eaux de pluie stagnantes l’hiver. La sécheresse estivale contribue également à appauvrir le sol.
Après avoir réglé le problème du drainage, grâce au creusement de petits fossés de 50 cm de profondeur, Chambrelent réalise que la culture de céréales s’avère quasi impossible. Il faudrait pour cela ajouter au sol sableux un mélange d’argile et de calcaire.
En revanche, la culture de pins maritimes peut tout à fait être envisagée pour l’assainissement des sols. En cinq ans, plus de 20 000 hectares sont transformés et ce n’est qu’un début.
Le succès de l’opération incite l’Empereur Napoléon III à généraliser la plantation de forêts de pins à partir de 1857.

Le bouleversement de la nature landaise marque la fin du pastoralisme. Le métier de berger ou de paysan disparaît au profit de celui de gemmeur ou d’exploitant de forêts. Les échasses ne se justifient plus et finissent par prendre la poussière dans les appentis. La sylviculture s’impose de manière écrasante en quelques décennies.
Le folklore pour ne pas oublier
Le berger landais juché sur ses échasses aura finalement vécu moins d’un siècle. Il a néanmoins marqué la culture landaise, peut-être grâce à l’originalité de son apparence.
Aujourd’hui, de nombreux groupes folkloriques contribuent à la réputation des échassiers. Ils perpétuent une tradition lancée au 19e siècle, consistant à utiliser les échasses pour des danses, des jeux ou des défis sportifs lors des fêtes de village ou autres évènements.
Le premier groupe folklorique a vu le jour en 1889 à Arcachon, sous l’impulsion de Sylvain Dornon, rendu célèbre par son exploit consistant à gravir les deux premiers étages de la tour Eiffel perché sur ses échasses. La toute première danse exécutée sur des échasses fut «Lou Quadrilh dous Tchancats ».
Les compétitions sportives comprennent la course de vitesse, dont la distance peut varier de 400 mètres à 5 km ; les raids de longue distance, jusqu’à 100 km, ou encore le gymkhana, une course organisée lors de la feria de Dax sur un parcours semé d’épreuves.