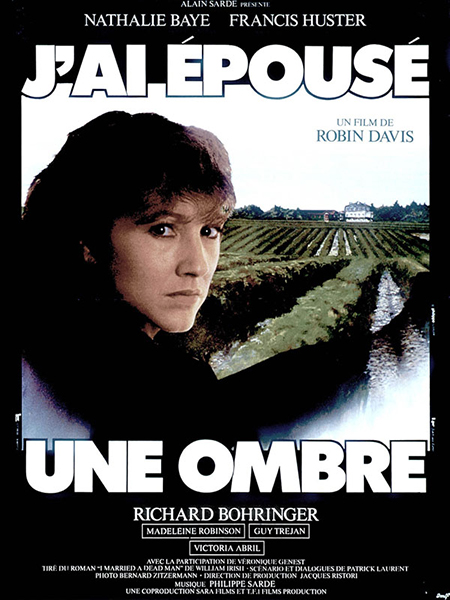Les marques emblématiques du Sud-Ouest (3/4) : Pyrenex
Depuis 160 ans, l’entreprise landaise collecte des plumes d’oies et de canards du Sud-Ouest pour concevoir des doudounes et des produits de literie vendus dans le monde entier.
Olivier Sorondo
14 janvier 2026 – MAJ 14 janvier 2026
Temps de lecture : 7 mn
Ecouter l’article

Une histoire familiale
Les gourmands associent assez rapidement le territoire des Landes au foie gras et/ou au magret de canard. Il est vrai que le département accueille de très nombreuses fermes d’élevage depuis déjà fort longtemps. Si leur viande constitue un mets de choix, les oies et les canards disposent également d’un atout non négligeable : leurs plumes.
Cela, Abel Crabos semble l’avoir compris dès 1859. À cette époque, il écume les marchés de Saint-Sever et des Landes pour collecter sa précieuse matière première. Au fil des années, Abel développe un véritable savoir-faire du traitement et de l’embellissement de la plume, qu’il transforme en panache, aigrette, boa ou ornement. Ses créations sont vendues aux chapelières, aux couturiers ou envoyées à Bordeaux et Paris.
L’atelier gagne en réputation grâce à la qualité de ses teintures (utilisant des pigments naturels) et la finesse de ses montages, ce qui lui vaut des commandes prestigieuses, y compris pour des événements comme le carnaval de Nice ou les bals parisiens.
En 1919, il acquiert le couvent des Ursulines de Saint-Sever – qui a perdu sa destination après la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État – pour le transformer en manufacture de plumes et duvets.
Six ans plus tard, René Crabos rejoint son père au sein de la société Abel Crabos & Fils. L’homme, qui n’est pas un inconnu, est considéré comme un joueur de rugby talentueux, capitaine du Racing Club de France et sélectionné en équipe nationale à de nombreuses reprises jusqu’en 1924.
René décide de n’utiliser que des duvets issus des Pyrénées, qu’il juge de meilleure qualité. Son épouse, Marie, conçoit à partir de 1942 les premières doudounes, qu’elle distribue aux prisonniers de guerre landais en Allemagne par l’intermédiaire de la Croix-Rouge.
Le virage industriel des années 1960
André Crabos, le fils de René et de Marie, intègre l’entreprise familiale, qu’il oriente vers la literie. La nouvelle activité tire le chiffre d’affaires grâce aux excellentes ventes d’édredons, d’oreillers et de couettes.
En 1967, son frère Jean-Pierre rejoint à son tour la société. Sa rencontre avec l’alpiniste et explorateur Louis Audoubert l’incite à concevoir les premières doudounes techniques. « Destinées aux sportifs, elles devaient résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. Depuis, on a sans cesse amélioré le processus de fabrication pour rendre nos doudounes ultra légères et isolantes » explique Éric Bacheré, l’actuel directeur général, à Audrey Levy de Paris Match.
La marque Pyrenex fait son apparition officielle en 1968. Elle évoque la chaîne de montagnes située non loin de Saint-Sever. En plus de fabriquer des produits de literie et des doudounes, l’entreprise conçoit des sacs de couchage, aussi légers et isolants que les vêtements, en plus de proposer un moelleux appréciable.
Le succès commercial est au rendez-vous. Pyrenex s’impose parmi les marques haut de gamme des doudounes et des combinaisons de ski. Au cours des années 1980, les exportations progressent, notamment au Japon et au Royaume-Uni portées par l’Authentic Jacket, le produit phare de la marque.
Pour Pyrenex, le savoir-faire permet une excellente maîtrise des processus de fabrication. « Les plumes sont dépoussiérées, stérilisées, séchées puis triées dans d’imposantes machines en bois au look suranné. Les plus grosses sont d’abord retirées et utilisées par l’industrie cosmétique, car riches en kératine, ou comme engrais. Reste ensuite les plumettes, sorte de ressorts naturels, que l’on fourre dans les oreillers et enfin le duvet, la partie la plus noble » détaille Elvire Emptaz dans le magazine Grazia.

Tradition et innovation
Impossible de balayer d’un revers de main plus de 150 ans d’expérience. La longue histoire de la famille Crabos contribue à la crédibilité et au positionnement des produits Pyrenex. Ainsi, les machines anciennes sont aujourd’hui pilotées par des programmes informatiques, sans pour autant perturber les procédés de la maison. Le but ? Apporter tout son pouvoir gonflant au duvet : « Calculé en cuin – cubic inch – il s’agit de la capacité pour un certain poids de garnissage à remplir un certain volume. Plus le volume occupé est grand, plus le duvet aura des performances d’isolation et de légèreté élevées » nous apprend le site Internet de la marque.
Autre atout de Pyrenex : la fleur de duvet. Aboutissement d’une longue expérience et d’une organisation dédiée, elle révèle des performances d’isolation et de légèreté exceptionnelles. Pyrenex la réserve à ses doudounes et couettes haut de gamme, avec la promesse d’un confort « sublimé ».
Si les articles de literie continuent d’être fabriqués dans les Landes, l’entreprise a dû se résoudre à délocaliser en Turquie et en Bulgarie la confection des doudounes. « Le montage des doudounes prend plusieurs heures et le coût de la main-d’œuvre pèse beaucoup sur le prix des produits. L’autre limite, c’est qu’il n’y a pas assez d’ateliers capables de les réaliser en France » indique Éric Bacheré au journal La Croix.
Aujourd’hui, Pyrenex soutient un rythme industriel tout en conservant son esprit artisanal. Chaque année, 200 000 doudounes, 800 000 oreillers et 200 000 couettes sont commercialisés. La gamme complète englobe150 références, pour une fourchette de prix comprise entre 500 et 1000 euros.
Les produits ont reçu le label de qualité Oeko-Tex, qui garantit l’absence de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement.
Être une marque de son temps
Dans un marché soumis à une forte concurrence, les initiatives constituent souvent de précieux relais de croissance, aussi bien en matière de création, de marketing que de pilotage de l’entreprise.
« Aller plus loin pour nous, cela a consisté, dès 2016, à adopter une stratégie résolument offensive en matière de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale » précise Edouard Crabos, le PDG, au journal Sud-Ouest. Au-delà de la recherche d’une certaine qualité, les clients se montrent aujourd’hui sensibles aux questions écologiques, de circuits courts, de traçabilité et de recyclage. Quasiment un argument de vente.
En 2020, Pyrenex reçoit le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV). Cette distinction, décernée par le ministère de l’Économie et des Finances, valorise l’excellence du savoir-faire.
Innover, c’est aussi savoir s’entourer. À partir de 2008, Pyrenex collabore avec de grands couturiers, dont Alexis Mabille et Alexandre Vauthier. La marque a quitté depuis longtemps les magasins de sport pour intégrer ceux dédiés à la mode. La signature des créateurs lui permet de s’installer dans des magasins prestigieux, à l’instar de Joyce à Tokyo ou Opening Ceremony à New York.
Pyrenex ouvre sa première boutique parisienne en 2015 puis une seconde en 2019. Sept boutiques constituent le réseau de la marque en France, en plus des 1 500 points de vente. L’exportation continue de jouer son rôle de locomotive, représentant 60 % du chiffre d’affaires.
L’entreprise a également mis en place depuis quelques années l’atelier « Made in Saint-Sever », uniquement dédié à de petites lignes de doudounes, fabriquées dans les Landes. L’objectif est de proposer des vêtements de luxe ultralégers, conçus à partir du « Duvet Legend » de Pyrenex, et reconnaissables grâce à leur couture de matelassage.
La qualité semble donc s’imposer comme un argument de pérennité. Pyrenex emploie aujourd’hui plus de 150 personnes, dont le savoir-faire apparaît fondamental. La famille Crabos a su, depuis le 19e siècle, exploiter tout le potentiel des plumes et duvets. « Notre concurrence est le produit synthétique. Mais une fois qu’une personne a essayé la fibre naturelle, il ne reviendra jamais au produit synthétique » constate d’ailleurs Edouard Crabos.