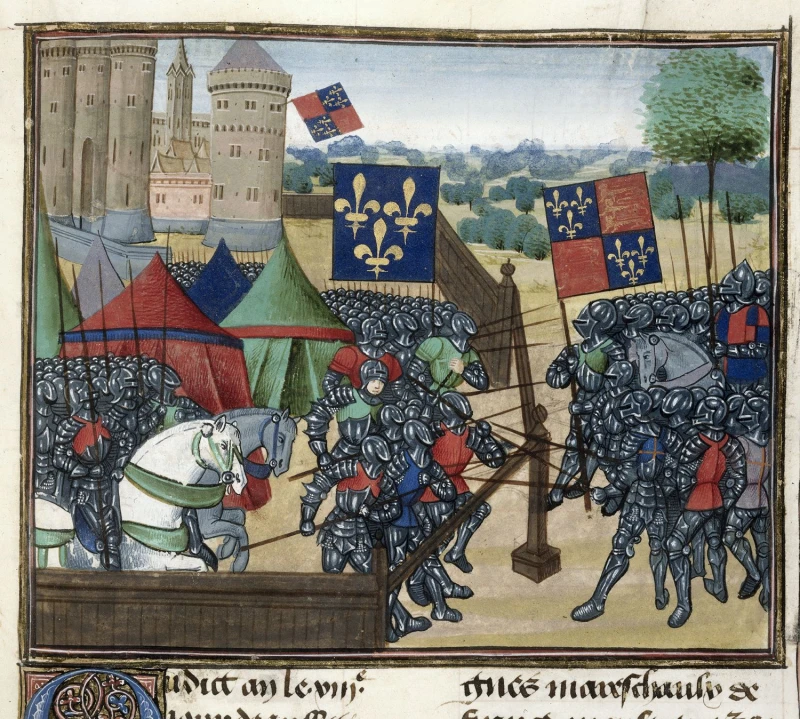Nature et paysages du Lot-et-Garonne
« Entre Agen et Marmande, c’est un paysage aussi beau que l’Italie; le charme des coteaux, la couleur de la terre, le costume, jusqu’au langage, évoquent les rives de Florence et de Sienne. Le Lot-et-Garonne est la Toscane de la France. » Stendhal
Olivier Sorondo – 28 mars 2016 – Dernière MAJ : le 13 mars 2020 à 21 h 38 min



Glou glou
Comme son nom l’indique, le Lot-et-Garonne est un département ouvert aux cours d’eau, assez nombreux sur le territoire si on y ajoute les rivières Baïse, Gers, Dropt, Séoune…
Si ces jolis cours d’eau façonnent le paysage, contribuent à lui donner son cachet particulier et constituent une richesse agricole, ils suscitent également une crainte bien légitime lorsque les inondations font leur apparition. La Garonne est, à ce titre, une maîtresse indomptable. Bien chargé en eau des Pyrénées et du Massif central, gonflé par le Lot en amont, le fleuve, dont le lit mineur souffre de son étroitesse, donne régulièrement naissance à des crues importantes, notamment lorsque la fonte des neiges a été massive dans les zones montagneuses. Le Lot n’épargne pas non plus son proche environnement, principalement au niveau de la vallée de Castelmoron-sur-Lot.
Ces débordements réguliers ont poussé les hommes à bâtir leurs cités sur la rive droite, en prenant soin d’anticiper une certaine hauteur de construction, comme l’illustrent les communes de Port-Sainte-Marie, Aiguillon et Tonneins. De nombreuses fermes ont quant à elles été construites sur des monticules.
Cette abondance d’eau apparaît être un argument de premier ordre lors des chaudes journées d’été. Grâce à un vaste système d’irrigation, les agriculteurs peuvent prétendre assurer une riche production sans trop de contraintes, asseyant de fait la réputation du Lot-et-Garonne comme territoire agricole incontournable du pays.
Il serait pourtant hasardeux de réduire le département à une seule et vaste exploitation. Moins populaire que sa voisine la Dordogne auprès des touristes, le Lot-et-Garonne affiche de solides arguments de séduction, tant par la beauté de ses paysages, l’authenticité de ses villages que par la richesse des pays qui le composent.
L’Agenais
À proximité d’Agen, coincé entre la Garonne au Sud et le Lot au Nord, le pays de Serres offre des paysages composés de plateaux calcaires donnant naissance à de petits ravins, de vallons encaissés et d’échines. Nombreuses y sont les petites exploitations agricoles à l’architecture périgourdine ou quercynoise. On y découvre aussi de fort jolies chapelles romanes, parfois isolées.
L’environnement du pays de Serres est propice à la faune, parmi laquelle il n’est pas rare d’observer le circaète (ou aigle des serpents), qui revient chaque année, le faucon crécerelle, le hibou petit duc ou, chez les mammifères, la genette, ce petit carnivore ô combien discret, habitué des bois, que l’on confond parfois avec un chat sauvage.
Plus au nord de la capitale lot-et-garonnaise, le pays du Brulhois (ou Bruilhois) affiche une multitude de vallons, terrasses et coteaux, emplacements parfaits pour les vignes dédiées aux cépages de tannat, de malbec, de fer servadou et d’abouriou dont on tire le vin noir, dû à sa robe très sombre.
L’Albret
À l’ouest du département, sur la rive gauche de la Garonne, coincé entre la Gironde et les Landes, le pays d’Albret présente un contraste paysager entre les collines de la région de Nérac, dédiées à la culture céréalière, et le plateau landais, qui prolonge la forêt de pins maritimes des Landes de Gascogne.
Nous sommes ici au cœur d’un territoire dédié aux plaisirs du palais, où pousse la vigne, où cacardent les oies, où grandissent les veaux sous leur mère et où volent les palombes.
La longue histoire de l’Albret se rencontre à travers ses cités et bastides (Nérac, Lannes, Vianne, Barbaste), ses châteaux, ses anciennes tanneries, ses moulins fortifiés et églises romanes.
C’est une invitation franche à remonter le temps et découvrir une terre toujours un peu secrète, dont on peut s’imprégner en naviguant sur la Baïse, sans trop de bruit.
Le Marmandais
Au nord-ouest du département, non loin du pays de l’Entre-Deux-Mers en Gironde, le Marmandais revendique une riche tradition vinicole, la vigne occupant les coteaux depuis l’époque romaine. On y cultive aussi la célèbre tomate de Marmande, des fraises, melons, prunes d’ente et autres fruits, les vergers étant très nombreux sur cette terre fertile.
La beauté du Marmandais repose sur la diversité de ses paysages, qui passe de la plaine de la Garonne aux vastes étendues de la forêt landaise. C’est aussi la ribambelle de petites communes installées le long du fleuve, chacune exhibant ses atouts architecturaux, comme les maisons à colombage de Clairac, la façade des quais de Tonneins, le château péager de Couthures-sur-Garonne…

Le pays du Dropt
C’est tout au nord du Lot-et-Garonne que se situe le pays du Dropt, ou plutôt la vallée du Dropt, au relief peu marqué, non loin de la Guyenne et du Périgord. On connaît ce petit pays essentiellement grâce à ses vignobles de Duras, qui façonnent le paysage. Il faut néanmoins parler des vastes forêts de châtaigniers, où les amateurs traquent des cèpes, des bois et des nombreux vergers.
Le paysage est reposant, incitant à la promenade, avec l’ambition de découvrir les nombreux villages moyenâgeux, où se tiennent chaque semaine des marchés assez extraordinaires. Les petits producteurs locaux proposent des pâtés faits maison, des poulets dodus et fermiers, des champignons à peine cueillis ou des écrevisses gesticulantes.
La découverte du pays du Dropt doit impérativement se faire à pied ou sur la selle d’un bon vélo afin de s’arrêter à tout moment devant les vieilles maisons à empilage, fort nombreuses dans la région, dans les petites rues des bastides, face aux pigeonniers restaurés. C’est aussi l’occasion de rencontrer les gens du coin ou de marquer une (longue) pause à la terrasse ensoleillée d’un bistrot typique, jamais loin d’un château ou d’une église remarquable.
Le pays du Lot
La région présente elle aussi un éventail de paysages très diversifiés. Des villages tels que Pujols et Penne d’Agenais ont été édifiés au sommet des coteaux, dominant la rive gauche du Lot.
Au Nord de la rivière, les bastides, à l’image de Monflanquin, forment un horizon vallonné, duquel se détachent les silhouettes des églises ou des tours d’angle.
La vallée du Lot est quant à elle réputée pour ses nombreuses cultures fruitières, en particulier celle de la prune d’ente, également commercialisée sous la forme du pruneau d’Agen après séchage.
La faune et la flore
La moyenne Garonne, entre les terrasses du fleuve et la plaine inondable, reste un lieu fréquenté par les poissons migrateurs, comme la lamproie marine, la truite de mer, la grande alose ou encore le saumon. On y trouve également des anguilles et des esturgeons, de taille moins impressionnante qu’il y a un demi-siècle.
En outre, le département offre plus de 500 hectares ouverts à la pêche, où les amoureux de la canne peuvent chatouiller la tanche, la carpe, le brochet et le goujon.
Plus au sec, les forêts de chênes sont habitées par quelques mammifères, dont des sangliers, des lièvres et lapins, des cerfs et chevreuils et même des visons d’Europe.
En levant les yeux, et selon les saisons, on peut apercevoir différentes espèces migratrices, à l’image du pigeon ramier, que l’on appelle palombe dans le Sud-Ouest, et dont la chasse, en octobre, suscite généralement une explosion de RTT ou de congés maladie.
Les autres oiseaux notables sont le héron cendré, de plus en plus sédentaire, le balbuzard pêcheur et le milan noir, un rapace qui considère le Lot-et-Garonne comme une bonne terre de drague.
Enfin, la région gasconne sait se faire belle en exhibant une grande variété de plantes et fleurs gracieuses, à la faveur de l’éclectisme géologique (argile, sable, calcaire…).

Il convient de citer en premier lieu une star locale, la tulipe agenaise, d’une belle couleur écarlate, introduite par les Romains il y a plus de 2 000 ans. Surnommée « l’œil du soleil » en raison de l’étoile jaune en son cœur, la fleur est malheureusement menacée d’extinction, à cause des pratiques horticoles et de la cueillette sauvage. Elle est aujourd’hui protégée.
Parmi les autres fleurs, les orchidées sauvages ravissent les botanistes et les amateurs de belles choses. On trouve des hybrides assez précieux, comme l’orchis pourpre, qui aime pousser sur les coteaux calcaires et les pelouses sèches. Nous pouvons aussi citer l’orchis brûlé ou l’ophrys mouche.
Les chênes pédonculés, très nombreux il y a quelques siècles, ont subi un rabotage de leur superficie, au profit des exploitations agricoles et des pins maritimes. Ils résistent cependant et continuent de former de vastes forêts, associés par exemple aux chênes sessiles, comme cela est observable dans la région du Mas-d’Agenais.
Les territoires du département se composent de nombreuses autres variétés d’arbres, tels le châtaignier, l’érable de Montpellier, le saule blanc et le genévrier.