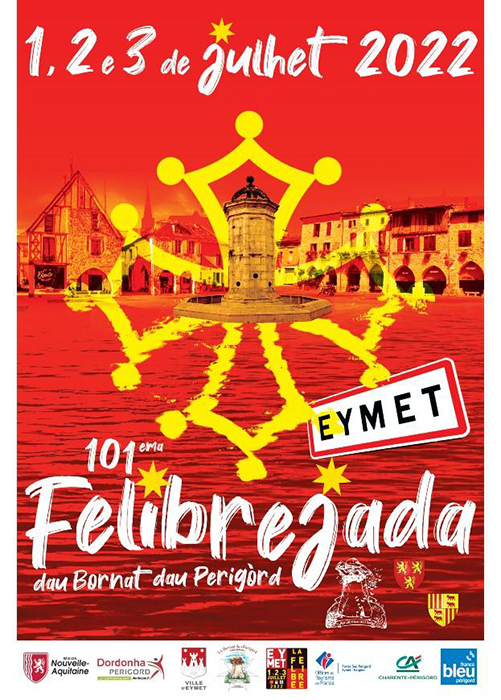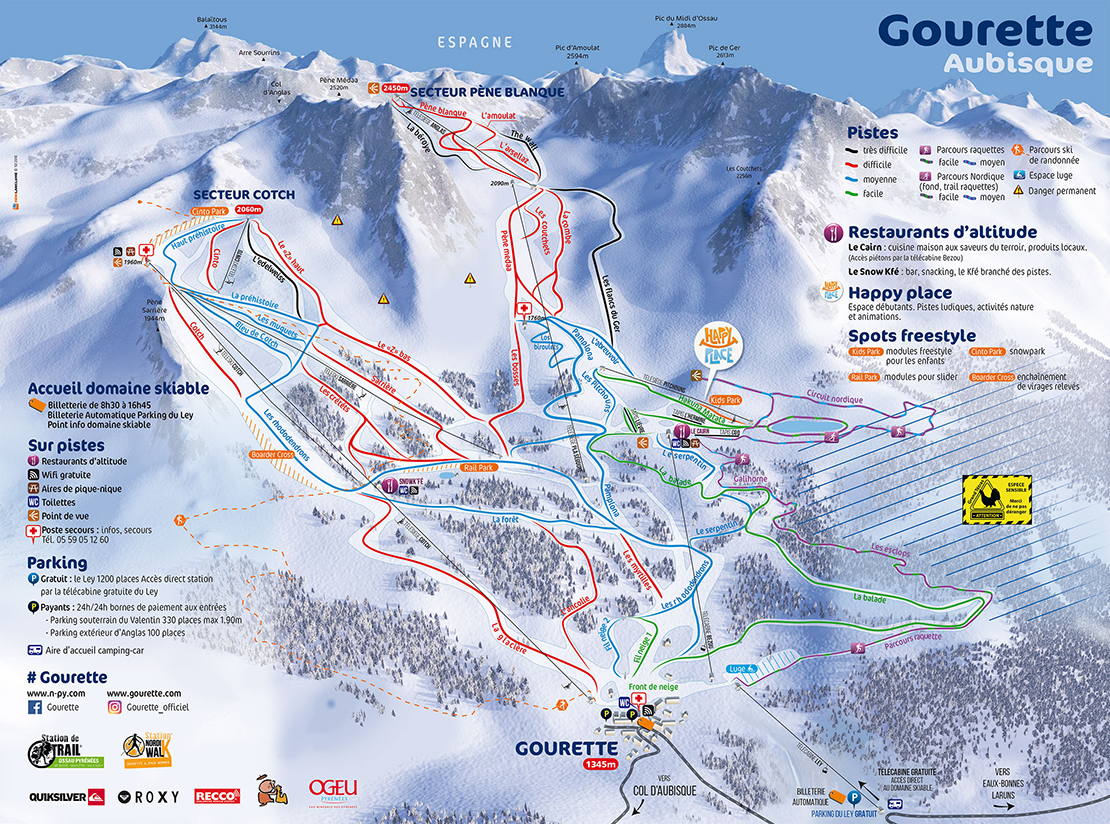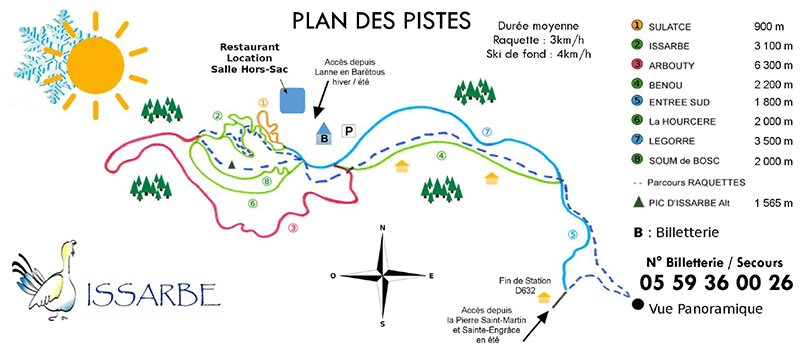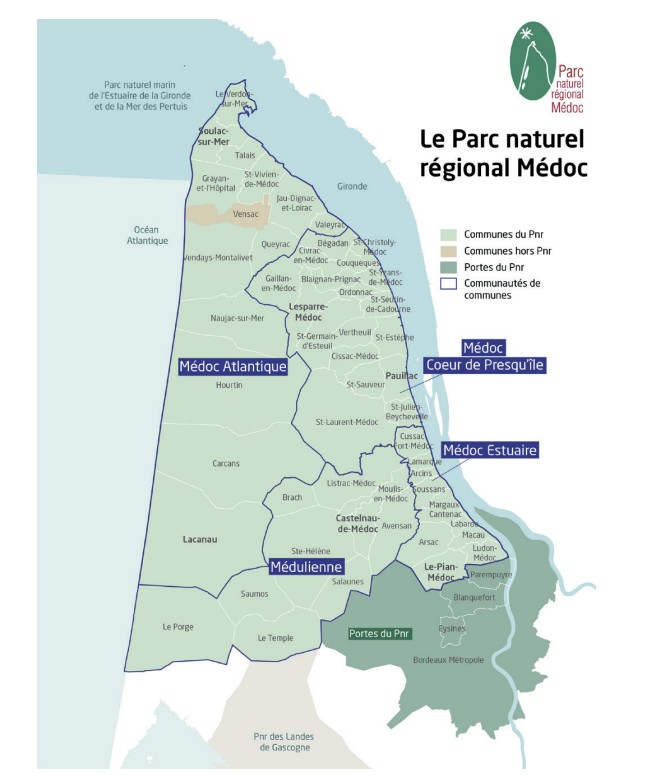Quelques destinations originales dans le Sud-Ouest
Mine de rien, la région regorge de petits endroits sympathiques pas toujours inscrits en tête de liste des lieux touristiques. C’est aussi ce qui fait leur charme.
Olivier Sorondo
6 août 2022 – Dernière MAJ : le 20 septembre 2022 à 10 h 54 min

Les Jardins d’eau de Carsac (24)
Non loin de Sarlat, au cœur du Périgord noir, se niche un petit paradis que n’aurait pas renié Claude Monet. Les Jardins d’eau de Carsac invitent, sur plus de 3 hectares, à une balade hors du temps. Ici, les lotus du Nil, les nymphéas exotiques et de nombreuses autres plantes aquatiques forment un univers enchanté. On le traverse en s’imprégnant des odeurs, en admirant la composition du paysage et en observant la faune, omniprésente. Ce sont les carpes Koï qui frétillent dans les bassins, les hérons cendrés et les aigrettes qui se régalent des têtards, les libellules qui frôlent les plantes ou encore les grenouilles, véritables maîtresses des lieux.
La visite se nourrit aussi d’un labyrinthe aquatique, dont la superficie dépasse les 3 000 m² et l’itinéraire se prolonge sur 550 mètres de passerelles. Il abrite une trentaine de variétés de lotus, plus de soixante espèces de nymphéas et 150 plantes diverses, parmi lesquelles les papyrus du Nil.
Labellisés « Jardin remarquable » en 2012 par le ministère de la Culture, les Jardins d’eau de Carsac promettent une parenthèse rafraîchissante au cœur de l’été et un retour raffiné à la nature.
Adresse : Saint Rome – 24200 CARSAC
Tél : 05 53 28 91 96
Horaires : Mai, juin et juillet : 10h à 19h – Août : 18h30 – Septembre : 11h à 18h.
Tarifs : Adulte : 8,50 € – Étudiants, jeunes (12 à 17 ans inclus), demandeurs d’emploi, personnes handicapées (indiv. et groupes) : 7 € – Enfants de 6 à 11 ans inclus : 5 €

Les Terres Blanches d’Espiet (33)
Si le Bassin d’Arcachon attire de très nombreux touristes chaque année, la Gironde recèle des destinations un peu plus intimes, mais non moins charmantes. Ainsi, à Espiet, village situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, les Terres Blanches épousent les contours du paradis. Le domaine, d’une superficie de 90 hectares, est né après des années de travaux, visant à transformer l’ancienne carrière d’un cimentier en lagon de carte postale.
Planté au milieu des vignobles et des forêts, le domaine se consacre aux plaisirs du farniente et de la baignade. Il est vrai que la plage de sable blanc et la vaste étendue d’eau turquoise promettent quelques heures d’abandon et de frissons de plaisir.
Mais le lieu se prête aussi et surtout aux plaisirs de la glisse aquatique. Le Windsor Wakeboard Camp, l’académie de wakeboard et de wakesurf, y a élu domicile, proposant des stages ou la location d’une large gamme d’équipements.
Ceux qui le souhaitent pourront déjeuner ou dîner au restaurant et même prolonger leur envie de détente au spa Les Petits Bains.
Adresse : 13 La Gueynotte – 33420 ESPIET
Tél : 06 11 51 68 24
Horaires : Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 heures à 19 heures.
Tarifs : Adulte : 5 € – Enfant de moins de 12 ans : 4 € – Réservation obligatoire en ligne.

La grotte de Lastournelle (47)
En cette période de forte chaleur, la recherche désespérée de fraîcheur peut aussi correspondre à une petite visite culturelle. A Sainte-Colombe, dans le Lot-et-Garonne, la grotte de Lastournelle laisse voir de magnifiques stalactites et stalagmites, mais aussi des coulées de calcite, des draperies et même des colonnes. C’est un spectacle naturel flamboyant qui s’offre au public à travers les sept salles de la grotte, sur plus de 300 mètres.
Pour ajouter un peu d’authenticité à la visite, il est possible de partir à la découverte des salles dans l’obscurité, avec sa seule lampe de poche comme accessoire de progression.
Découverte en 1878 par un paysan qui creuse un puits, la grotte de Lastournelle fait l’objet de quelques explorations. En 1955, les propriétaires du terrain, Joseph et Maria Brys, mettent à jour l’entrée naturelle de la cavité. Un passage est finalement dégagé, permettant un accès plus aisé aux salles et à ses trésors minéraux.
Des animations sont régulièrement proposées au public, comme des chasses au trésor, à même de ravir les enfants.
Un petit restaurant, une boutique et des jeux pour les petits sont proposés aux visiteurs.
Adresse : 1851 Route des Grottes de Lastournelle – 47300 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE
Tél : 05 53 40 08 09
Horaires : Avril à décembre – Horaires des visites variables suivant l’affluence.
Tarifs : Adulte : 7,50 € – Enfant (de 4 à 14 ans) : 5 €

L’Esturgeonnière du Teich (33)
Depuis déjà quelques années, le caviar français s’impose parmi les meilleurs du monde. Le département de la Gironde contribue grandement à la production, notamment grâce au Moulin de la Cassadote à Biganos et au Caviar Perlita, situé non loin, au Teich.
L’établissement ouvre régulièrement ses portes afin de dévoiler toutes les étapes de fabrication du précieux aliment. Fondée en 1990, la ferme aquacole de L’Esturgeonnière s’est d’abord destinée à la production de chair d’esturgeon, avant de se tourner vers le caviar, au terme d’importants travaux.
Aujourd’hui, l’entreprise assure l’ensemble du processus de production, de la naissance des alevins au conditionnement du caviar. Le site profite de la proximité d’une source géothermale, qui préserve la température de l’eau tout au long de l’année. Grâce à une station de traitement dotée d’une double filtration, les eaux ressortent propres dans les milieux naturels avoisinants.
La visite permet donc de s’immiscer dans l’univers si particulier de la production de caviar, servi dans les restaurants gastronomiques de la planète. C’est aussi l’occasion de prendre (un peu) part à la fête puisqu’une dégustation est même proposée au public.
Adresse : Route de Mios Balanos – 33470 LE TEICH
Tél : 05 56 22 69 50
Horaires : Avril à septembre, uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : Adulte : 30 € – Enfant (de 8 à 12 ans) : 24 €