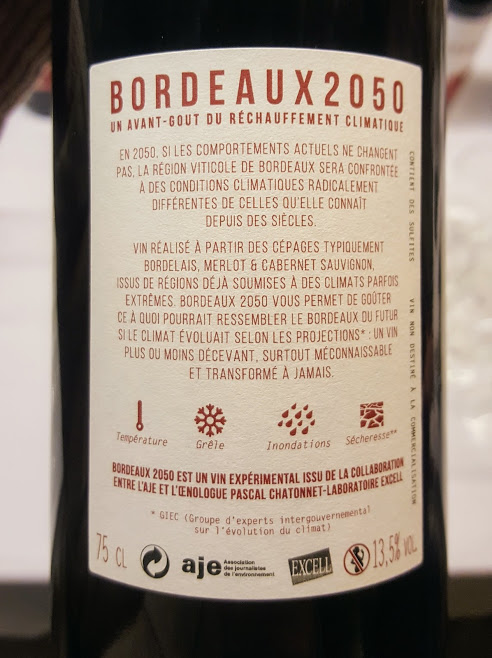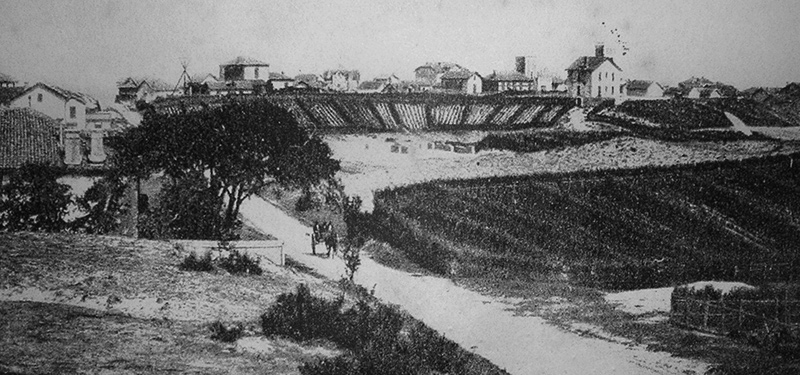La bière artisanale made in Sud-Ouest
La région n’a pas échappé à l’essor des microbrasseries, chacune revendiquant son ancrage local et la particularité de sa production. Si le marché s’est un peu resserré, les petits brasseurs du Sud-Ouest continuent d’exister face aux géants du commerce.
Olivier Sorondo
4 décembre 2025 – MAJ le 4 décembre 2025
Temps de lecture : 7 mn
Ecouter l’article

Un phénomène assez récent
C’est au Royaume-Uni qu’a émergé le phénomène des microbrasseries dans les années 1970 avant de s’étendre aux Etats-Unis une dizaine d’années plus tard. En France, il faut attendre les années 2000 pour voir apparaître les premiers établissements. Le pays ne comptait que 250 brasseries indépendantes en 2006, contre environ 2500 aujourd’hui.
Mais qu’est-ce qu’une microbrasserie au juste ? Le site La Brasserie Fondamentale propose sa définition : « Les microbrasseries sont des petites brasseries permettant de brasser de la bière en quantité limitée et étant indépendantes de toute autre brasserie. Une microbrasserie, c’est aussi un brasseur qui élabore ses propres recettes dans un souci de créativité et de qualité de manière expérimentale et à l’écoute des consommateurs. »
Selon l’expert Emmanuel Gillard, dont l’étude a été reprise dans le magazine Bar Mag, les brasseries indépendantes intègrent les picobrasseries (production annuelle inférieure à 200 hl), les microbrasseries (entre 200 et 999 hl) les PME (entre 1000 et 9 999 hl) et enfin les structures semi-industrielles (entre 10 000 et 200 000 hl).
« Les brasseries produisant moins de 1 000 hectolitres (picobrasseries et microbrasseries) totalisent à peine plus de 1% de la production alors qu’elles constituent 80% des brasseries françaises » précise l’expert.
Ces dernières années, elles ont dû faire face à une conjoncture difficile, liée à une baisse de la consommation des ménages, une augmentation des charges d’exploitation et un manque de trésorerie. « De l’avis de plusieurs acteurs et observateurs, après la phase d’engouement où beaucoup se sont lancés dans l’aventure, c’est maintenant une phase de régulation du marché qui s’est mise en œuvre, où seuls les mieux armés subsisteront » constate le journal l’Écho du Mardi.
Jouer la proximité…
Inutile donc pour les microbrasseurs de chercher à perturber un marché toujours largement dominé par les industriels. Leur pérennité repose avant tout sur les attentes des consommateurs : des produits meilleurs que ceux de la grande distribution et, surtout, composés d’ingrédients cultivés localement.
Trouver par exemple du houblon dans le Sud-Ouest relève parfois du défi, mais la filière semble s’organiser, comme le montre la démarche menée par Houblon Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les acteurs régionaux. Ces derniers privilégient de plus en plus la diversification agricole face au changement climatique et à l’appauvrissement des sols dû à la monoculture. « Ces dernières années, les récoltes de prunes ont été catastrophiques à cause des gelées. Nous ne voulions plus concentrer les risques sur une seule culture. Or, le houblon ne souffre pas du gel. Son deuxième avantage ? Les pieds durent une vingtaine d’années. Nous récoltons dès la première année alors qu’il faut plusieurs années pour un fruitier ou un pied de vigne » témoigne Émeric Cadalen, agriculteur du Lot-et-Garonne, cité par Curieux !
En revanche, la production d’orge répond aux attentes des brasseurs, grâce aux 132 000 hectares qui lui sont dévolus dans la région (40 % de cette production concerne l’orge brassicole).
Ainsi, au Pays basque, l’association Herriko Garagarnoa, située à Ainhice-Mongelos, forme un collectif d’agriculteurs, de malteurs et de brasseurs basques, avec une forte revendication locale. Cette année, 16 hectares ont été semés, après des années d’analyse des sols et d’ajustement. « Une démarche patiente, presque clinique, qui a permis d’identifier enfin les types d’orges les plus compatibles avec les terroirs du Pays basque Nord » nous apprend Presse Lib. Aujourd’hui, Herriko Garagarnoa fournit neuf brasseries locales.
… et la diversification
La proximité ne se limite pas à la quête de fournisseurs départementaux ou régionaux. Jouer la carte locale suppose de s’inspirer du terroir. Ainsi, en Gironde, la brasserie Effet Papillon propose sa Brett Series, une bière de blé nature mûrie en barriques et en foudres de chêne ayant contenu du vin rouge. Pour sa part, Château Caillou (Grand Cru Classé) a élaboré une bière élevée dans ses fûts de Sauternes, la Bayou.
Dans le Lot-et-Garonne, les consommateurs peuvent trouver la Genèse, une bière préparée à base de pruneau d’Agen, qui apporte « une note particulière de prune très douce. » À Limeuil, en Dordogne, la brasserie La Lutine mise sur sa bière bio à la noix, non filtrée et non pasteurisée. Quant à la microbrasserie Epic, localisée à Boulazac, elle commercialise depuis peu une bière brune à la truffe du Périgord !

Les microbrasseries du Sud-Ouest ont tout intérêt à répondre aux attentes de leur clientèle, parfois exigeante. Ignorer par exemple les ingrédients bio ne contribuerait pas à donner la meilleure image de sa production, pas plus que de ne pas proposer de bières peu ou pas alcoolisées, dont les ventes ne cessent d’augmenter selon la Fédération Nationale des Boissons.
Il s’agit également de concevoir une bière de qualité, car souvent plus chère que celles disponibles en grande surface. Les bières artisanales sont souvent non filtrées et non pasteurisées et refermentées en bouteille, ce qui permet d’offrir une expérience gustative nouvelle, voire surprenante, au public, loin des standards d’Heineken ou de Carlberg.
Enfin, l’ancrage local se traduit par une implication dans l’animation de son territoire. Outre la vente directe ou en circuit court, les brasseries indépendantes assoient leur réputation en organisant différents évènements tout au long de l’année (ateliers de brassage, visites, soirées, concerts) ou en s’impliquant dans les fêtes locales. C’est particulièrement vrai dans le Sud-Ouest, destination touristique.
Que de brasseries !
La vague des microbrasseries n’a pas épargné la Nouvelle-Aquitaine. La région compte environ 240 établissements indépendants, ce qui en fait la troisième région française en nombre, derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie. Ce sont majoritairement de petites structures, souvent installées en milieu rural, qui produisent moins de 300 hectolitres par an.
En Dordogne, à Périgueux, la brasserie BAM profite de son large espace (plus de 1000 m²) pour proposer une taproom à sa clientèle, qui déguste les bières maison directement sur le lieu de production. Elle peut ainsi découvrir des boissons surprenantes, dans le plus pur esprit « craft beer », comme l’illustre la Tatou, une blonde légèrement amère avec des saveurs d’agrumes et de fruits tropicaux.
Une quarantaine de microbrasseries sévit en Gironde, royaume de la viticulture. De nombreux nouveaux brasseurs sont d’ailleurs issus du monde de la vigne, à l’instar d’Alexandra Martet, propriétaire de Château Lavison, dans l’Entre-Deux-Mers. La vigneronne a créé en 2017 la Brasserie du Château, sûre de son fait : « Il y a une très grande curiosité pour la bière de la part des clients, plus que sur le vin » confie-t-elle au quotidien Sud-Ouest. La brasserie propose aujourd’hui quatre étiquettes, dont la bière de Printemps, élaborée à partir d’une recette du Moyen-Âge. Il est vrai que son château date du 13e siècle.
Dans les Landes et le Lot-et-Garonne, les brasseries artisanales s’activent surtout en milieu rural, privilégiant la qualité, l’originalité et les circuits courts. Certaines sont d’ailleurs certifiées « Artisan Gourmand Nouvelle-Aquitaine », à l’instar de Kanaha Beer, microbrasserie installée à Biscarrosse, qui produit la Honu, une bière aux fruits de la passion, ou encore la Whisky Ale, affinée au whisky.
Enfin, existe-t-il une rivalité entre brasseurs basques et béarnais ? Non, les deux territoires partagent une philosophie similaire, fondée sur la valorisation du terroir. Chez les Basques, l’innovation repose sur les produits locaux, comme le piment d’Espelette utilisé par exemple par la brasserie Etxeko Bob’s Beer. Du côté béarnais, la brasserie Aussau n’hésite pas à proposer sa bière d’hiver n°18, avec des notes de chocolat, de caramel et d’épices, particulièrement adaptée à l’environnement pyrénéen lorsque la neige se met à tomber.