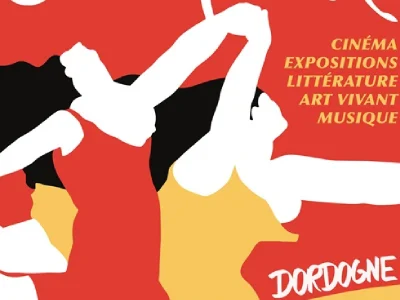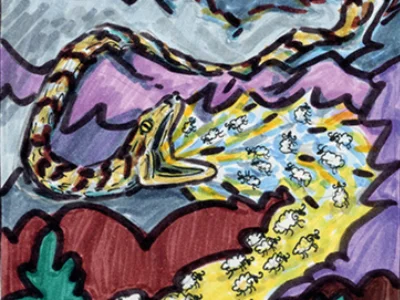Le Festival La Chevêche, qui tient son nom d’un petit rapace nocturne, vous propose plusieurs jours d’immersion en compagnie de spécialistes, à la découverte de la biodiversité locale et des acteurs de sa préservation et de sa valorisation.
Du 21 au 23 mars 2025 à Nontron, de nombreuses animations pour petits et grands seront proposées sur le thème « santé environnementale » (conférences, forum, sorties, expositions, projections, ateliers créatifs…).
Cet événement est une initiative du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Périgord-Limousin.
Le thème de la 13e édition du festival
La 13ème édition du festival nature la chevêche, centrée autour de la santé environnementale, questionne sur l’interconnexion des organismes vivants et des écosystèmes, comment la santé des uns dépend de celle des autres.
Le festival nature est entièrement dédié à la découverte du vivant, à la transition écologique et aux acteurs qui s’engagent pour un développement durable.
Le festival permet aux acteurs et aux visiteurs de découvrir des initiatives du territoire et d’acquérir des éléments de réponse face à une situation à laquelle ils sont tous confrontés.
Programme :
Vendredi 21 mars
17h30 – 18h30 : Conférence « Biologie d’un envahisseur en Nouvelle-Aquitaine : le moustique tigre Aedes albopictus ». avec Aurélien Mercier, docteur en parasitologie, maître de Conférences des Universités en parasitologie à la Faculté de pharmacie de Limoges.
Lieu : salle des fêtes
18h30 : Soirée d’ouverture
Restauration locale et de saison par le foodtruck Pascaline traiteur.
20h30 : Ciné-discussion « La fabrique des pandémies » de Marie-Monique Robin.
En présence de la réalisatrice, Marie-Monique Robin
Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.
Dédicace avec la librairie La Lisière
Cette séance sera suivie d’une discussion sur le thème « Comment préserver la biodiversité pour protéger notre santé ? », à partir des questions du public, avec Marie-Monique Robin (réalisatrice et écrivaine) et Aurélien Mercier (écologue de formation et docteur en parasitologie à la faculté de pharmacie de Limoges).
Au cinéma Louis Delluc
Prix unique : 5,50 €
Samedi 22 mars
9h30-11h45 : Visite par Yanis Marcillaud, écologue forestier du CETEF, d’une forêt gérée de façon durable, plus résistante au bouleversement climatique
Le changement climatique augmente les risques de tempête et de dépérissement des forêts.
Cette visite guidée permettra de comprendre comment une forêt naturelle est plus résistante au bouleversement climatique. Vous découvrirez pourquoi préserver et favoriser la biodiversité est indispensable au fonctionnement des écosystèmes. Nous vous présenterons des méthodes d’exploitation forestière, leurs avantages et inconvénients. Vous découvrirez ainsi comment gérer de façon durable une forêt, dans le respect de la biodiversité, tout en produisant du bois pour vos besoins.
Pour réserver la visite de la forêt gérée durablement, rendez-vous sur :www.cetefnouvelle-aquitaine.org
Prévoir chaussures/bottes selon la météo, imperméable, vêtements chauds.
Départ possible à 9h30 du parking devant la Maison des sports à Nontron, en co-voiturage.
11h : Actualités des acteurs nature
Présentation des actions autour du nesting, Ma Maison ma santé, Bilan de santé environnementale avec Céline Coupeau de Lib’elles Lune.
Lieu : salle des fêtes
11h à 12h : Atelier proposé par les étudiants de l’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier Ménigoute (IFFCAM).
Découvrez leurs films à la projection, samedi 23 mars, à 13h30, au cinéma Louis Delluc.
Lieu : rendez-vous au stand de l’IFFCAM au Forum de la nature – Maison des sports.
12h : Inauguration du forum de la nature et cocktail de bienvenue.
A la salle des fêtes à Nontron
12h–18h : Le Forum de la Nature
Artistes, naturalistes, institutions publiques seront présents pour faire connaitre au grand public leurs actions en faveur de la protection, de la préservation, de la connaissance de la biodiversité ! Pour partager leurs savoir-faire, leurs passions ! Pour sensibiliser à l’urgence des transitions écologiques, sociales, énergétiques.
45 participants : ateliers, expositions, lectures, démonstrations, espace ludique, jeux immersifs et en bois…
Maison des sports et salle des fêtes.
13h30 : Conférence « Les blobs et les fourmis, leurs interactions, leurs alimentations et leurs liens avec la santée avec Audrey Dussutour, directrice de recherche au Centre de recherches sur la cognition animale et spécialiste du comportement animal à Toulouse.
Découvrez là sur la vidéo Le Blob – AUDREY DUSSUTOUR– Ideas in Science
Lieu : salle des fêtes
13h30 à 15h30 : Projections de films naturalistes/environnementaux réalisés par les étudiants de l’IFFCAM : l’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute.
« Rendez-vous nocturnes » de Anthony Gloaguen
« Bêtes du bitume » de Camille Rolland
« Avec le courant dérivent mes souvenirs » de Eliot Madier
Au cinéma Louis Delluc
14h-15h30 : Sortie à la découverte des plantes au Centre Hospitalier de Nontron.
A la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales avec la Petite Serpette.
Sur réservation par mail stage@lapetiteserpette.fr ou par téléphone 06 84 30 69 28.
Prix libre. Limité à 15 personnes
Lieu : Rendez-vous devant la Maison des Sports
15h30-16h : Atelier « Ma Maison, ma santé » avec Céline Coupeau, éco-infirmière de Lib’elles Lune.
Atelier pour mieux décrypter les gestes et produits pour un quotidien plus sain (qualité de l’air intérieur, produits ménagers, cosmétiques, ameublement, déco, ondes, aliment et contenant…).
Gratuit, sur inscription au stand, limité à 12 personnes.
Lieu : salle des fêtes
16h30-17h30 : Atelier d’initiation à la linogravure avec Maeva Vignal, destiné aux enfants, utilisant du polystyrène comme support pour apprendre les bases de la gravure et de l’impression de manière ludique et adaptée à leur âge.
Réservation au stand – prix unique : 5 €.
Lieu : salle des fêtes
17h30 : Débat « Les idées reçues sur la santé environnementale ! » Animé par Hugo Struna, journaliste scientifique à Euractiv France.
La santé environnementale est un domaine crucial qui relie notre santé à notre environnement, en abordant les liens étroits avec la biodiversité, le sol, l’eau, l’air, l’alimentation et nos activités quotidiennes.
Les invité.e.s :
Camille Chotard, chargée de projet Amélioration de la qualité de l’air Intérieur au Conseil Départemental de la Dordogne
Virginie Layadi, responsable Qualité du Centre Hospitalier de Guéret
Aurélien Mercier, maître de Conférences des Universités en Parasitologie à la Faculté de Pharmacie de Limoges
Céline Coupeau, éco-Infirmière, pour Lib’elles Lune.
Au cinéma Louis Delluc
18h30 – 23h : Repas festif par les foodtrucks !
21h : Spectacle « Billion Dollar Baby » par Audrey Vernon
De et avec Audrey Vernon !
Mise en scène de Dorian Rossel et Delphine Lanza (Cie STT- Suisse).
Après « Comment épouser un milliardaire » qui fustigeait le monde des ultras riches, Audrey Vernon veut sauver la planète et make the World green again… tant qu’il est encore temps !
Si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui diriez-vous ?
Enceinte, elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître.
Spectacle tout public. A partir de 12 ans.
Prix adhérent : 12 € ; Prix unique : 16 €.
Billetterie sur Hello Asso : www.helloasso.com
Lieu : salle des fêtes
Dimanche 23 mars
9h30-12h : Sortie initiation au greffage
Apprends les techniques de greffage et repars avec ton arbre !
Pourquoi on greffe et comment…
Un essai sur branches mortes pour faire les erreurs avant de passer aux choses sérieuses
ZOOM sur le fonctionnement d’un arbre, les sèves, le cambium…, une fois que les participants sont entrés dans le vif du sujet.
Choix du greffon et greffe sur porte-greffe. Ligature. Chacun repart avec SON arbre et ça, ça fait plaisir !!!
Matériel : chaque personne doit prévoir 1 couteau et 1 sécateur.
Prix : 15€. Sur inscription : Christophe au 07 63 73 57 92 ou sur contact@fermedesdeuxchenes.fr
Lieu : rendez-vous devant la Maison des sports, co-voiturage possible.
9h30-10h15 : Lecture de l’album « Oust ! Du balai !! » suivie d’un atelier dessin / coloriage des personnages de l’histoire.
Pour les enfants de 3/8 ans. Avec Vincent Dhuicque.
Lieu : salle des fêtes.
10h–17h : Le Forum de la Nature
45 participants : ateliers, expositions, lectures, démonstrations, espace ludique, jeux immersifs et en bois…
Maison des sports.
10h30 – 12h : Ciné p’tit dej’ – Odyssée mare de Léa Collober.
« Qui n’a jamais rêvé d’explorer le cosmos à la recherche des êtres fantasmagoriques qui le peupleraient ? Et si vous découvriez qu’il est possible d’observer cette vie-là, juste sous vos yeux ? »
Il a reçu le Lirou d’or à Ménigoute 2024 !
Plongez dans l’infiniment proche ! Découvez un extrait sur La salamandre, Odyssée mare de Léa Collober.
Gourmandises proposées par le Jardin des Chaos Granitiques.
A partir de 4 ans.
Tarif unique : 4,5 €
Lieu : cinéma Louis Delluc
10h30 – 12h30 : Jeu « Toute une santé ! » avec Céline Mougard de Nature, Santé & Territoire, sous réserve.
Un jeu collaboratif de mise en situation dont l’objectif est de maintenir un territoire en bonne santé, ce qui inclut : l’équilibre des milieux (eau, air, sols), une biodiversité animale et végétale fonctionnelle et des humains en bonne santé physique, psychologique et sociale. Les joueurs devront tenter collectivement de faire monter la jauge « Une Seule Santé ».
A destination des élus, chargés de missions de la fonction publique, professionnels de santé, de l’éducation à l’environnement, de l’enseignement, de l’agriculture, etc.
Sur réservation. Limité à 15 personnes.
Lieu : salle des fêtes
11h : Dédicace et échanges sur la BD « Sous nos pieds », avec l’auteur Nathanaël Brelin, proposée par la librairie coopérative L’Autre Librairie.
Lieu : salle des fêtes
11h-12h30 : Sortie à la découverte des plantes
A la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales sur la voie verte de Nontron avec la Petite Serpette.
Prix unique 5€/personne et gratuit pour les enfants (moins de 12 ans).
Lieu : Rendez-vous devant la Maison des Sports.
11h30-12h15 : Fabrication de pain de graines pour les oiseaux – L’hiver est passé mais un autre peut se préparer. Les pains de graines suspendus (blocs, boules) peuvent constituer un important complément alimentaire pour les oiseaux, lors de ces périodes de disette et c’est surtout une bonne aide pour de belles observations. Venez fabriquer vos propres pains de graines avec La Lisière, en intérieur ! Petite itinérance extérieure dans la foulée si les conditions météorologiques le permettent.
Prix Libre. Places limitées.
Sur réservation auprès de la Librairie La Lisière à Aubeterre-sur-Dronne, contact@aubeterrelibrairie.com et 06 76 83 18 82.
Lieu : rendez-vous à la buvette, hall de la salle des fêtes.
11h30-12h30 : Présentation du programme DIALOGUE
Quelle(s) forêt(s) en Périgord Vert pour 2050 ?
Débat proposé par les élèves de la cité scolaire de Nontron entre les élèves, les habitants, les élus et les intéressés.
En partenariat avec Cap sciences.
Lieu : salle des fêtes
14h-16h : Table ronde – La santé et l’alimentation
Cette table ronde propose d’explorer les liens fascinants entre notre alimentation, notre microbiote intestinal et la santé de notre planète.
Ce moment d’échange sera l’occasion de discuter des solutions concrètes pour favoriser une alimentation plus saine, plus accessible, tout en tenant compte des enjeux environnementaux et de santé. L’objectif est de susciter une réflexion collective sur les actions à mettre en place pour améliorer notre bien-être tout en préservant notre planète.
Animé par Hugo Struna, journaliste scientifique à Euractiv France.
Les invité.e.s :
Marjorie Soulhol, paysanne herboriste à Mareuil (24340), l’Herbe Folle
Céline Mougard, créatrice de l’entreprise Nature, Santé & Territoire
Clément Papiau, bénévole à Hêtre Coop, épicerie coopérative à Magnac sur Touvre
Invité surprise.
Lieu : salle des fêtes
16h30 : Concert ambulant de Récupère Cucu et Professeur Shadoko !
2 Ripeurs en tenue jaune fluo et casqués le Père Cucu et le Professeur Shadoko, avec leur poubelle customisée et aménagée pour faire de la musique : Nous sommes en quête de la mine d’or dur dans le quartier, aidez-nous à la trouver, aidez-nous à pousser la poubelle, à ramasser tous les déchets que l’on verra en route, aidez-nous à les trier à la fin. Nous distribuons à chaque participant un exquis mot, et un gazoogène.
Conseillé à à partir de 5 ans.
Clôture festive du festival !
Lieu : spectacle musical à la place des Droits de l’Homme – lieu du festival !