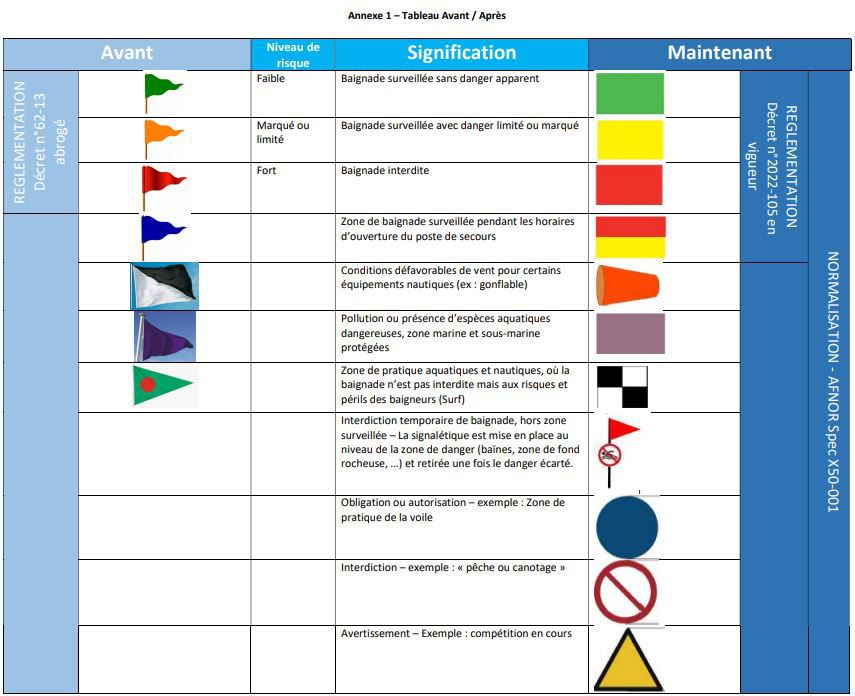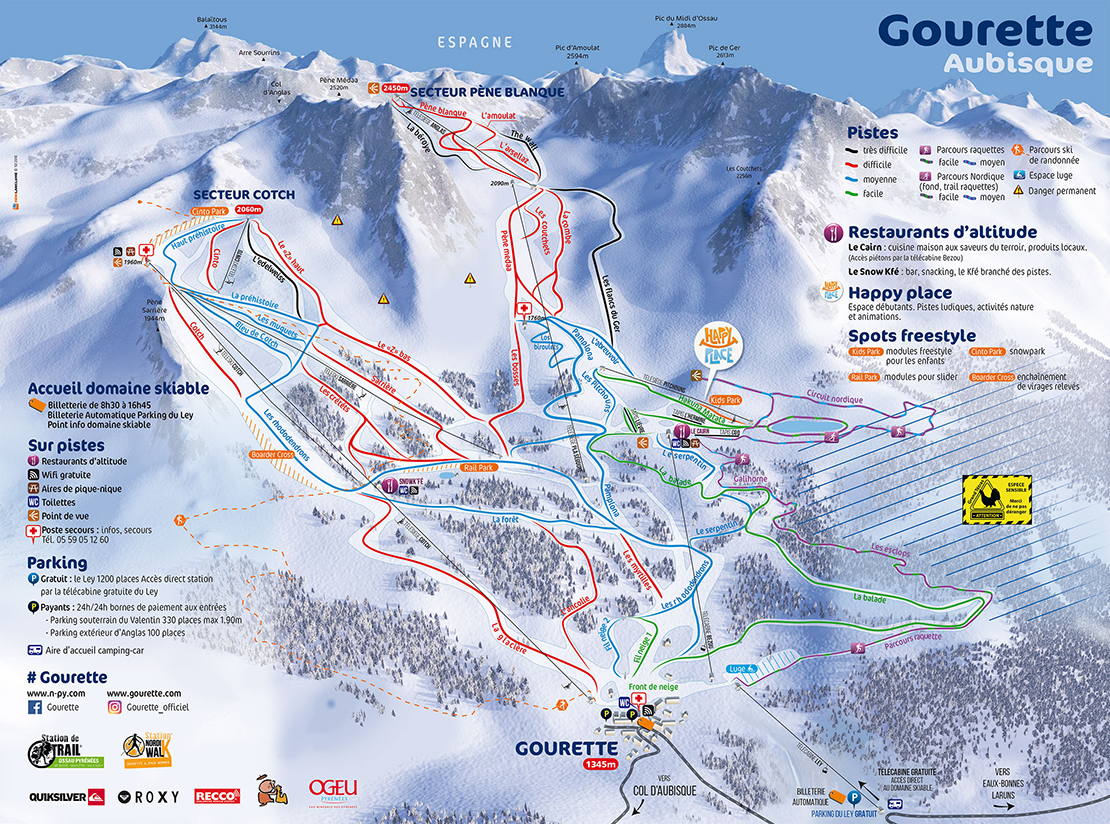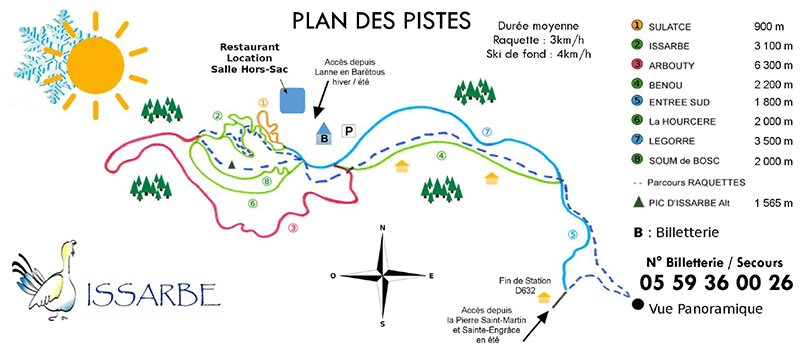Sagarnoa : ne parlez plus de cidre basque !
Consommé depuis des siècles par les Basques, le sagarnoa (ou sagardoa) est considéré à tort comme un cidre local. La différence se veut plus subtile.
Olivier Sorondo
6 septembre 2022 – Dernière MAJ : le 20 septembre 2022 à 14 h 39 min

Boisson traditionnelle du Pays basque
Les pommiers occupent depuis fort longtemps les terres basques, propices à leur développement. Fort logiquement, les autochtones ont su en tirer profit en aménageant des vergers et des pommeraies. Devenue incontournable, la pomme s’est imposée comme la reine des fruits et l’unique ingrédient d’une boisson rattachée à la culture locale : le sagarnoa.
Ce terme basque désigne le « vin de pomme », et non pas le cidre. Le malentendu persiste depuis quelques siècles. Peut-être est-il dû à une traduction erronée puisque le terme basque « sagarnoa » équivaut au mot espagnol « sidra », lui-même (faussement) traduit « cidre » dans la langue de Molière. Cette double traduction a donc initié une mauvaise désignation du divin breuvage en France.
Une approche plus technique confirme d’ailleurs cette confusion. La règlementation française relative au cidre impose une fermentation de moûts de pommes fraîches, extraits avec ou sans addition d’eau. De plus, le cidre doit afficher un titre alcoométrique volumétrique de 5% au minimum, une acidité volatile maximale de 1g/litre et une teneur en sucres résiduels de 35 g/litre.
Pour sa part, le sagarnoa n’est pas pétillant et ne reçoit aucun ajout de sucre. Essentiellement produit en Espagne, il atteint 2,2 g d’acidité, un niveau plus élevé que le cidre, et un degré d’alcool à 6°.
Le vin de pomme basque laisse deviner des saveurs équilibrées et un caractère affirmé. Il est apprécié à l’apéritif, en accompagnement de délicieux tapas ou pintxos.
Des origines lointaines
Mythes, légendes et théories entourent l’apparition des pommiers au Pays basque. Certains estiment que les arbres fruitiers ont été introduits par les Arabes. D’autres considèrent que les Romains les auraient plantés lors de leur grande invasion. Quelques pistes évoquent même le rôle des oiseaux migrateurs, porteurs de pépins de pommes.
Il n’en demeure pas moins que le climat humide et tempéré du Pays basque a encouragé l’exploitation des pommiers. Les premières traces écrites seraient celles de règlements, ordonnances et décrets royaux publiés en 1189, relatifs aux pommeraies du Labourd.
Les pèlerins, en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mentionnent eux aussi l’existence de vastes plantations au 12e siècle.
Il convient enfin de mentionner les écrits des « fueros », dédiés à la plantation des arbres et au commerce du sagarnoa, qui livrent des conseils sur la protection des pommiers contre les animaux et les voleurs.

Si la boisson emblématique du Pays basque s’installe assez largement dans les foyers, elle conquiert ses lettres de noblesse grâce aux marins. Ces derniers embarquent de nombreux tonneaux à bord de leur voilier avant de rejoindre les eaux froides de l’Atlantique pour pécher la morue et chasser la baleine. Le sagarnoa s’impose comme le remède parfait contre le scorbut grâce à son apport en vitamine C. Les contrats stipulent d’ailleurs que chaque membre d’équipage doit en boire entre deux et trois litres chaque jour. On imagine les joyeux chants basques sur le pont des bateaux !
Le vin de pomme, tout au long des siècles, contribue à la renommée du Pays basque et à sa puissance économique. La culture s’intensifie et les pressoirs se multiplient sur le territoire.
L’âge d’or du sagarnoa atteint son apogée au 16e siècle. L’introduction progressive de nouvelles cultures, dont celle du maïs, grignote les pommeraies. Au 20e siècle, la guerre civile espagnole et l’essor industriel relèguent la boisson basque à un moindre niveau de production et de consommation.
Heureusement, la province du Guipuscoa a su conserver les ressources et le savoir-faire, malgré la fermeture de nombreux pressoirs. La résilience des producteurs locaux a permis d’éviter la disparition de cette boisson emblématique, toujours appréciée aujourd’hui.
La production aujourd’hui
Le Pays basque compte une soixantaine de cidreries, dont la majorité se situe logiquement en Guipuscoa. Les établissements misent sur le regain des consommateurs pour étoffer les pommeraies et profiter de fruits locaux. Environ 400 hectares supplémentaires permettraient de ne plus dépendre des pommes venues de Normandie et même de République tchèque. Elles représentent aujourd’hui plus de la moitié de la matière première.
Le mouvement semble amorcé du côté français. De nouvelles variétés sont plantées et testées, en complément des pommes déjà connues comme l’Ondomotxa, la Peatxa et la Txakala. Plus d’un millier de variétés a été recensé.
La fabrication du sagarnoa débute bien sûr par la récolte des pommes, entre septembre et décembre. Les fruits sont ensuite lavés, triés, pressés avant de reposer quelques heures afin de décanter le moût. Il s’ensuit l’importante étape de la fermentation, dans des conditions de températures basses. Le jus de pomme est stocké dans des kupelas (tonneaux) pendant une période de quatre à huit semaines, nécessaire à la transformation du sucre en alcool.
Le produit final est un vin de pomme non pétillant, dont la teneur en alcool se situe entre 5 et 6°. Son goût équilibré et acidulé résulte du choix des pommes douces, acides et amères. Le léger perlé qui caractérise le sagarnoa (on ne parle même pas d’effervescence) provient du gaz résiduel généré pendant la fermentation.
Chaque producteur donne naissance à une boisson différente. Pour Bixintxo Aphaule, cité par le site En Pays basque, « la diversité est intéressante. Plusieurs producteurs font sensiblement le même travail à plusieurs endroits du Pays basque, pourtant aucun de leurs cidres n’a le même goût. »
La différence apparaît également entre le Nord et Sud du Pays basque. En Espagne, le sagarnoa est plus sec et acidulé.
Les niveaux de consommation varient énormément des deux côtés de la frontière, le sagarnoa étant lié à une certaine habitude culturelle du côté espagnol.
Le rôle crucial des sagarnotegis
Les cidreries, ou plutôt les « sagarnotegis », ont su préserver cet héritage de la culture basque, essentiellement dans les provinces espagnoles. Lorsque vient enfin le temps de la dégustation, de la mi-janvier à la fin avril, le public se presse nombreux dans les chais afin de se prêter à l’exercice du « Txotx ».
Il s’agit en quelque sorte d’un rituel. Les sagarnotegis proposent à leurs clients un repas roboratif, dont le menu, composé de produits locaux, ne varie pas d’un établissement à un autre : omelette à la morue, dés de morue frite, txuletta (côte de bœuf) cuite au feu de bois, fromage de brebis accompagné de confiture de coing et de noix. Le moment se veut convivial grâce aux grandes tablées et aux plats généreux dans lesquels chacun se sert.

Dès que le maître des lieux crie « Txotx ! » pour annoncer l’ouverture d’une kupela après avoir retiré le bouchon, les convives sont invités à se rapprocher munis de leur verre. La mission est simple, mais requiert un peu d’habilité : placer son verre sous le jet de sagarnoa en l’inclinant légèrement et en remontant jusqu’à la source. L’opération vise à provoquer une oxygénation rapide de la boisson afin de l’apprécier davantage. La règle sous-jacente suppose de ne pas remplir son verre, car les dégustations se multiplient au fur et à mesure de l’ouverture des tonneaux. Chaque kupela révèle en effet un sagarnoa au goût différent.
Si l’écrasante majorité des sagarnotegis se situe au Sud du Pays basque, quelques établissements parviennent à faire vivre la tradition dans les provinces localisées en France, à l’instar de Txopinondo. La « cidrerie » artisanale, créée en 1999, ouvre ses portes tout au long de l’année à Ascain. On y retrouve l’esprit des sagarnotegis en profitant d’une visite des lieux et des explications sur la fabrication du sagarnoa.
Txotx !