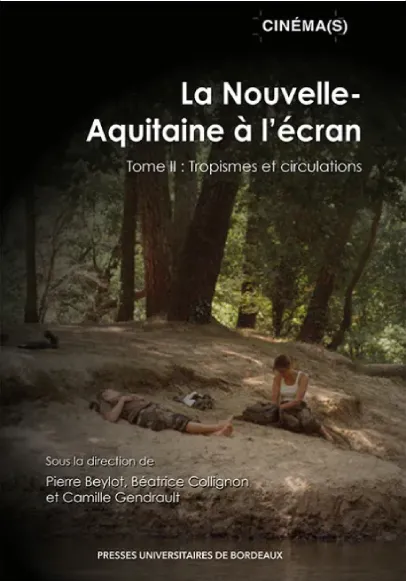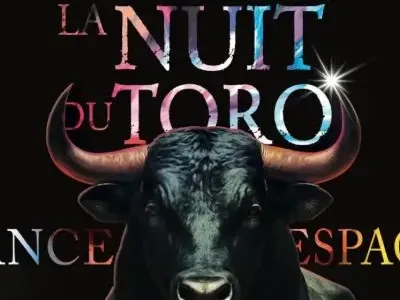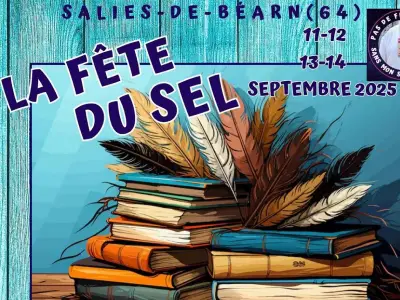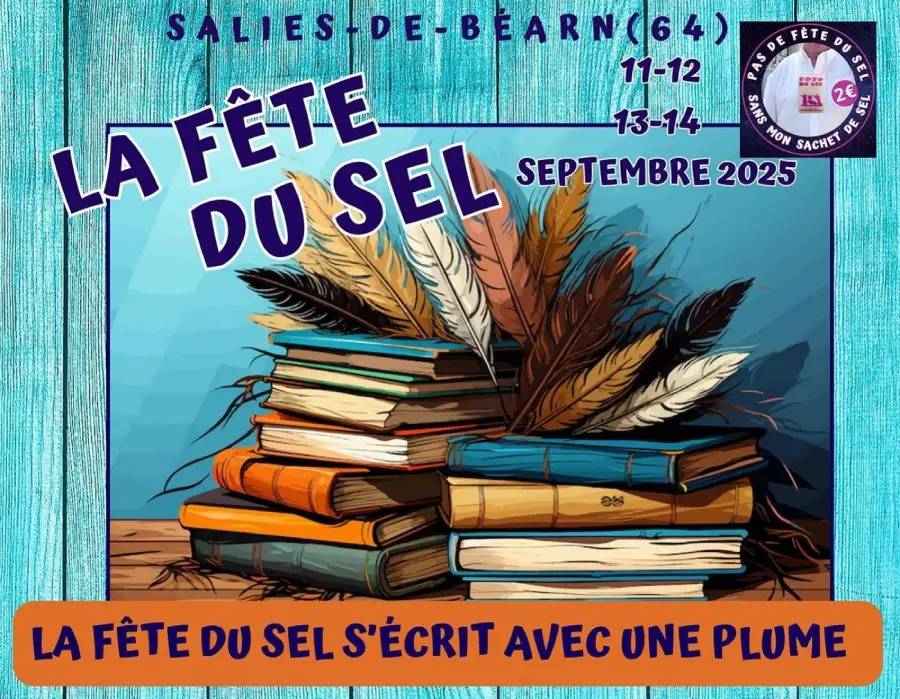Le Lot-et-Garonne, terre de mystères
Châteaux médiévaux, constructions mégalithiques, forêts denses, ruines… Le patrimoine ancien du Lot-et-Garonne se prête fort bien aux mythes et mystères qui font parfois froid dans le dos.
Olivier Sorondo
14 septembre 2025 – MAJ 30 septembre 2025
Temps de lecture : 5 mn
Ecouter l’article

Le château de Bonaguil, sa Dame blanche et ses fantômes
Fièrement juché sur un éperon rocheux à toute proximité du village de Saint-Front-sur-Lémance, le château de Bonaguil fut érigé au XIIIe siècle puis transformé en forteresse par le puissant Bérenger de Roquefeuil deux siècles plus tard.
En 1761, Marguerite de Fumel rachète l’imposant monument et y apporte de nombreux aménagements, dont la construction de nouveaux appartements et la transformation des sept ponts-levis en ponts-dormants.
Elle s’éteint peu avant la Révolution française et n’assiste pas au saccage du château décidé par une loi de 1793. Les tours sont décapitées, le corps de logis détruit, les boiseries arrachées, le mobilier dispersé…
Est-ce cette désolation qui aurait poussé l’esprit de Marguerite de Fumel à venir hanter Bonaguil ? La légende raconte qu’à chaque mois de novembre, une Dame blanche erre dans les salles et couloirs obscurs du château. Ses pleurs précèdent souvent son apparition.

Le quotidien Sud-Ouest rappelle qu’il y a quelques années, une équipe de l’émission RIP (Recherches, Investigations, Paranormal) est venue mener son enquête. « Équipée de plusieurs moyens technologiques permettant d’entrer en communication avec de possibles fantômes, elle y a passé deux nuits et a rapporté des faits troublants : sensation de pression sur le corps, de brûlures, bruits étranges, chute de température brutale… »
On rapporte aussi la présence d’autres spectres, dont celui d’une nièce de Bérenger de Roquefeuil, qui aurait refusé d’épouser l’homme imposé par son oncle. Fou de colère, ce dernier l’aurait emmurée dans le donjon.
Enfin, le mystère de Bonaguil tient aussi en ses graffitis exécutés à la pointe sèche sur les murs internes de la grosse tour. Ils représentent notamment des portraits de femmes, la silhouette d’un fantôme et un carré Sator, considéré comme magique. Il contient le palindrome latin SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS et suscite diverses hypothèses parmi les savants, qui ont aussi retrouvé sa trace à Pompéi.
Las Naou Peyros, repère de sorcières
La jolie petite commune de Réaup-Lisse, située non loin de Nérac, abrite un cromlech, c’est-à-dire une enceinte mégalithique composée de monolithes agencés en cercle et délimitant une surface. Un tel site reste assez rare en Aquitaine, les cromlechs étant surtout présents dans les pays nordiques et les îles britanniques.
Celui de Réaup-Lisse, nommé Las Naou Peyros (Les neuf Pierres), mentionné depuis 1587, est connu comme ayant été un cimetière. De fait, les nombreuses fouilles organisées ont révélé des ossements humains (dont un squelette placé au centre de l’édifice), des fragments de silex et des restes de poteries.
Si les fouilles ont endommagé le site, elles n’ont pas altéré les nombreuses croyances et légendes qui l’entourent. Peut-être sont-elles dues à l’atmosphère sonore particulière du lieu, où l’on entend paraît-il les pierres siffler dès que se lève le vent. Ces mêmes pierres bougeraient d’elles-mêmes ou changeraient de place certaines nuits, renforçant l’idée qu’elles possèdent une puissance mystérieuse.

Ce sont d’ailleurs les pierres de Las Naou Peyros, comme d’autres sites mégalithiques, qui ont attiré les sorcières depuis des siècles. Aux solstices d’été et d’hiver, mais aussi aux nuits de pleine lune, elles se seraient réunies pour danser, invoquer les esprits et pratiquer des rituels mystérieux.
Les paysans, dit-on, n’osaient pas s’approcher la nuit de peur de voir surgir des flammes, des ombres ou d’entendre des chants étranges.
Selon certaines versions, les sorcières choisissaient les pierres comme point de passage entre le monde des vivants et celui de l’invisible, un portail sacré qui ne s’ouvrait que certaines nuits.
Une autre tradition laisse penser qu’un trésor fabuleux était caché. Personne ne sait vraiment ce qu’il contient (or antique, objets sacrés, offrandes des anciens peuples ?), mais il serait protégé par un serpent gigantesque, parfois comparé à un dragon. Selon la tradition orale, quiconque tenterait de déterrer les pierres sans affronter la créature serait maudit, ou englouti par la terre qui se refermerait sur lui.
Le trésor du prieuré Saint-Sardos de Laurenque
Les spectres ou sorcières ne nourrissent pas toujours les légendes locales. Ainsi, le prieuré Saint-Sardos, situé dans le hameau de Laurenque non loin de Gavaudun, accueillit des religieuses dès le XIIe siècle. Celles-ci y restèrent jusqu’à la destruction du noble bâtiment par les protestants, en 1569, alors qu’éclataient les Guerres de religion.
Obligées de fuir, la mère supérieure et les religieuses auraient jeté dans le puits du prieuré le trésor du couvent afin qu’il ne soit pas volé. Les huguenots auraient ensuite tenté de le récupérer, mais un violent orage aurait subitement comblé le puits.
On raconte que, plus tard, des pièces d’or auraient été retrouvées à flanc de coteau dans les eaux de la source du Touron, et en aval dans la rivière la Lède, ce qui crédibiliserait la légende.

Depuis, chaque fois qu’on tente des fouilles ou des recherches à l’endroit supposé, un orage survient, empêchant les travaux. Mais quand le soleil revient, les eaux de la source s’illuminent et l’on voit des reflets d’or apporter une touche de magie au lieu.
La légende est toujours entretenue par les conteurs locaux, pour le plus grand plaisir des habitants de Gavaudun. Elle reflète l’attachement des habitants à leur patrimoine et à leur histoire, tout en entretenant une part de mystère qui fascine les visiteurs.