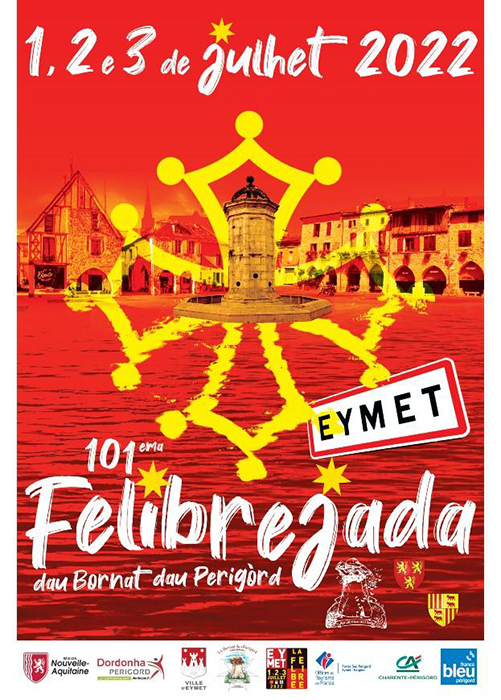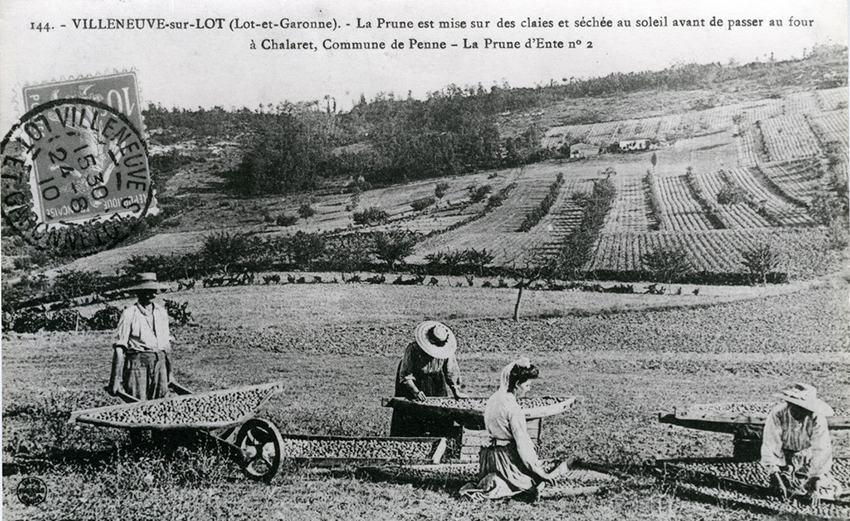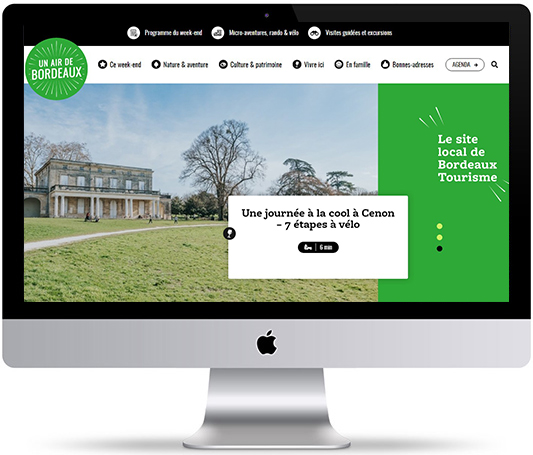Marathon du Médoc : boire ou courir, pourquoi choisir ?
Lancé en 1985 par une bande de copains médecins, le Marathon des châteaux du Médoc, organisé chaque année en septembre, donne la part belle à l’ambiance festive et à la dégustation des crus de la région.
Olivier Sorondo
15 juin 2022 – Dernière MAJ : le 21 juin 2022 à 19 h 44 min

Une course à contre-courant
On le sait, le marathon et ses 42,195 km règlementaires imposent un physique affûté, un entraînement régulier et une hygiène de vie irréprochable. Le visage des athlètes marqué par l’effort contribue à la légende de cette course particulière.
New York, Paris, Berlin, Tokyo… Autant de villes réputées qui accueillent chaque année des milliers de coureurs venus du monde entier, sous le regard des médias internationaux.
Pourtant, dans le Sud-Ouest de la France, et à Pessac plus précisément, un évènement suscite une curiosité croissante et un engouement jamais démenti.
Lancé en 1985 par six amis et la Commanderie du Bontemps (confrérie viticole), le Marathon des Châteaux du Médoc a immédiatement joué la carte de la singularité. L’un des fondateurs raconte :
« À cette époque, les courses en France sont destinées à la performance pour la plupart et l’ambiance s’en ressent ; les « ringards » dont nous faisons partie ont parfois l’impression de déranger. Pourquoi ne pas créer un évènement festif et sportif se basant sur nos richesses naturelles, la région, ses châteaux et ses vins, notre amour du bien-vivre, notre expérience de marathoniens qui nous permet d’aller au-devant de l’attente de nos coureurs et enfin notre passion commune ? »
Le pari peut sembler de prime abord un peu décalé. Entourer une épreuve de marathon d’une ambiance folle et de la dégustation de crus du Médoc ne correspond pas au modèle du genre. Et pourtant, le succès accompagne la première édition, en réunissant plus de 500 coureurs quand le Marathon de Bordeaux n’en attire pas plus de 200.
C’est le début d’une grande aventure sportivo-festive, bâtie sur quatre piliers : spectacle, santé, vin et sport.
Privilégier le « fun effort »
Les vignobles et châteaux du Médoc constituent le cadre et le cœur du marathon. Il faut avouer que les appellations Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Médoc et Haut-Médoc suscitent presque instinctivement l’envie de dégustation, même chez les athlètes.
De fait, une vingtaine d’étapes jalonne le parcours. Organisées par les propriétaires des domaines, elles permettent de se désaltérer en profitant d’un petit verre de vin goûtu. Certains marathoniens s’accordent le temps de la dégustation, d’autres privilégient un cul sec afin d’atteindre le prochain stand dans les meilleurs temps.
Le maître mot est celui du plaisir. « La vaste majorité des coureurs, dont le nombre est limité volontairement à 8 500 et qui viennent de 75 pays, ne se sont pas inscrits dans l’espoir de vaincre, mais de faire la fête » écrit fort justement Michel Arseneault dans L’Actualité (5 février 2020).
Ici, l’obsession du chrono est tout à fait relative. L’évènement est d’ailleurs qualifié de « marathon le plus long du monde » au regard du temps que s’accordent les sportifs lors des pauses aux points relais.

Les 22 stands de dégustation de grands crus ne sont pas les seuls à enchanter les papilles. Dès le 28e kilomètre, des huîtres sont proposées aux athlètes, prélude à un repas roboratif. Car, oui, c’est bien le fumet d’entrecôtes grillées sur sarments de vigne qui chatouille les narines au 39e kilomètre (proche de l’arrivée). Les insatiables marquent deux nouveaux arrêts, d’abord pour déguster le fromage, ensuite pour s’enfiler une glace.
Il arrive parfois que certains marathoniens franchissent la ligne d’arrivée en titubant, peut-être à cause d’arrêts prolongés aux stands ou de douleurs musculaires. Malgré la bienveillance qui entoure la compétition, les organisateurs imposent un temps de course maximal de 6 heures 30, au risque de finir dans la voiture-balai. On devine qu’elle rentre rarement vide.
C’est la fête !
Proposer des grands crus et de savoureux plats, c’est bien. Mais le Marathon du Médoc revendique avant tout son esprit festif. C’est la raison pour laquelle les coureurs sont encouragés à se déguiser avant de prendre le départ. Honte à tous ceux qui conserveraient short et débardeur !
Les déguisements suivent le thème annuel du marathon. Ainsi, en 2019, les participants ont pu enfiler des costumes de super-héros. L’année précédente, c’est le thème de la fête foraine qui s’est imposé. Cette année, le public aura peut-être le sentiment d’être au Festival de Cannes puisque la thématique retenue est celle du cinéma. Ce sera sûrement l’occasion de voir James Bond courir aux côtés de Dark Vador et d’un T-rex échappé de Jurassic Park.
L’ambiance de fête se veut omniprésente. Dès la veille de la course, la soirée Mille-Pâtes accueille 1500 convives dans l’un des châteaux partenaires. Apéritif dans les jardins, dîner, dégustation des crus du domaine, bal… Les marathoniens invités ont peut-être intérêt à ne pas trop tarder.
En plus des pauses dégustation, la course s’organise autour d’une cinquantaine d’animations tout au long du tracé : orchestres, bandas, danses improvisées, ateliers, spectacles divers.
C’est aussi l’un des secrets de la réussite du marathon. Le public, toujours très nombreux, est partie prenante des festivités. Il contribue directement à la convivialité et à la bonne humeur.
« Pour Conor Clune, un Irlandais qui en est à son sixième marathon, celui du Médoc est le plus chaleureux de tous. Plus encore, admet-il à contrecœur, que celui de Dublin. « Durant tout le parcours, les gens voient nos prénoms sur nos dossards et crient : “Allez, Conor !”, “Courage, Conor !” Ça change tout. Ailleurs, le public nous encourage. Ici, il nous aime. » (L’Actualité, 5 février 2020).
La fête se poursuit en soirée et en musique, bien après la fin de la course. Le lendemain, la balade de récupération permet à 4000 personnes de partir à la découverte des vignobles, avec des arrêts dans quelques châteaux, qui ressortent les bouteilles pour l’occasion.
La santé comme fil conducteur
Toutes ces joyeuses initiatives n’occultent en rien le souci de santé qui se doit d’entourer un marathon. La course est longue, la chaleur parfois étouffante, l’effort permanent malgré les pauses.
Ainsi, le congrès médical et le colloque médico-sportif, organisés la veille du marathon, suivent l’objectif d’apporter au public et athlètes des informations précises sur la pratique d’un sport d’endurance et les pathologies qui peuvent en résulter.
La course elle-même permet d’observer au plus près l’état physique et de santé des coureurs. Sont ainsi menées des milliers d’études cardiologiques, électrocardiographiques, tensionnelles, mais aussi podologiques, digestives ou épidémiologiques.
Tout au long de l’épreuve, 300 personnes assurent l’assistance médicale et une dizaine de postes de soins jalonnent le tracé. La ligne d’arrivée franchie, les participants peuvent trouver réconfort et assistance dans cinq tentes mises à leur disposition.
Les verres de vin servis pendant le marathon ne sont bien sûr jamais remplis à ras bord. Il s’agit plutôt d’un fond, surtout destiné à faire découvrir et apprécier le cru d’un domaine. De même, les entrecôtes grillées sont servies découpées en petits morceaux et ne sont proposées qu’en fin de parcours. La distribution de bouteilles d’eau se veut permanente.
Les marathoniens sont des sportifs accomplis et connaissent leurs possibilités et limites. Si le contexte festif du Marathon du Médoc les incite à moins se soucier du classement et du chrono, ils savent que la distance de 42,195 km reste une redoutable épreuve. Cette vision est bien sûr partagée par les organisateurs.
En conclusion, le Marathon des Châteaux du Médoc aura superbement réussi son pari. Grâce à la mobilisation de 3000 bénévoles, il est aujourd’hui considéré comme un évènement incontournable pour les coureurs et le public. Sa réputation a dépassé depuis longtemps les frontières, puisque des milliers de marathoniens venus du monde entier y participent.
Surtout, il a réussi à raboter la notion de compétition au profit de la convivialité et du plaisir commun de partager un moment précieux. Largement de quoi lever son verre.