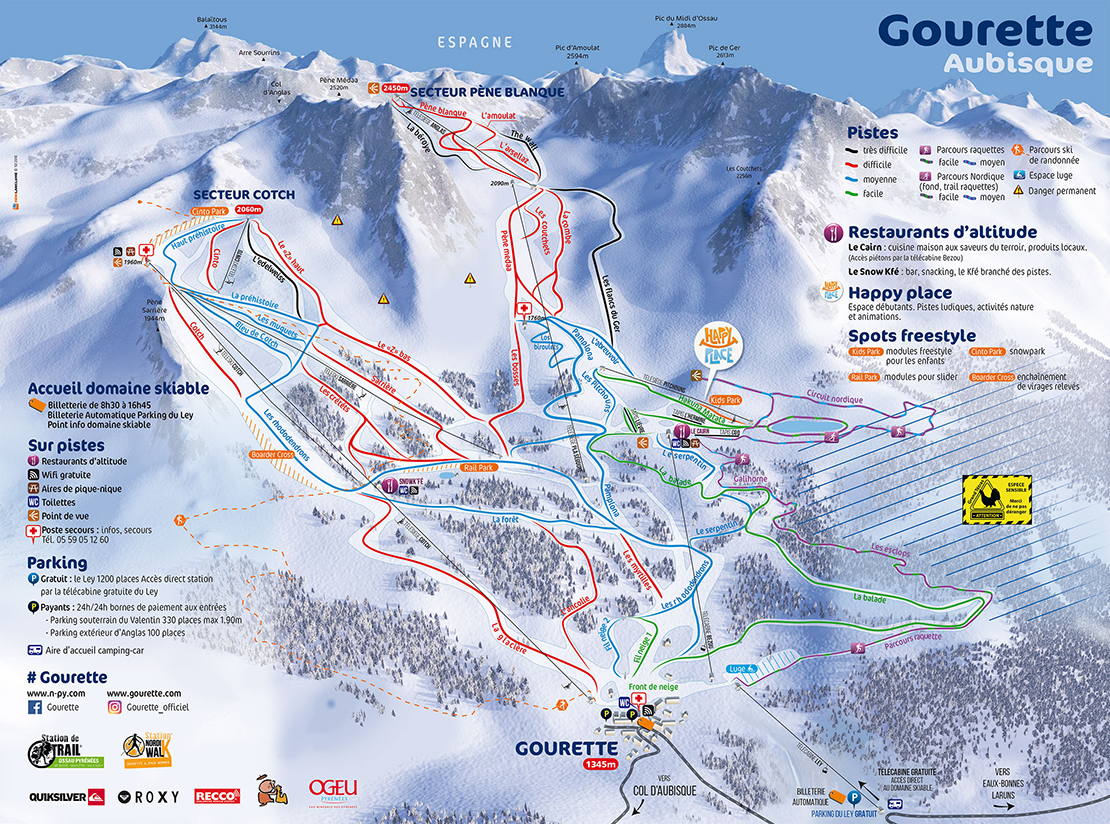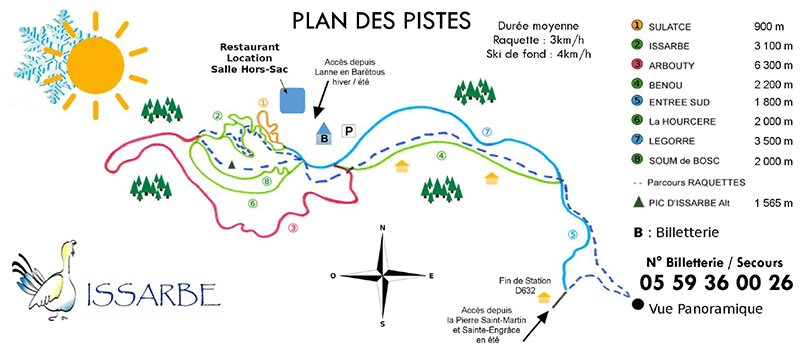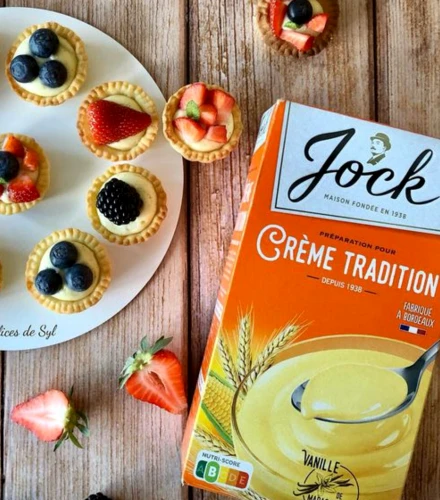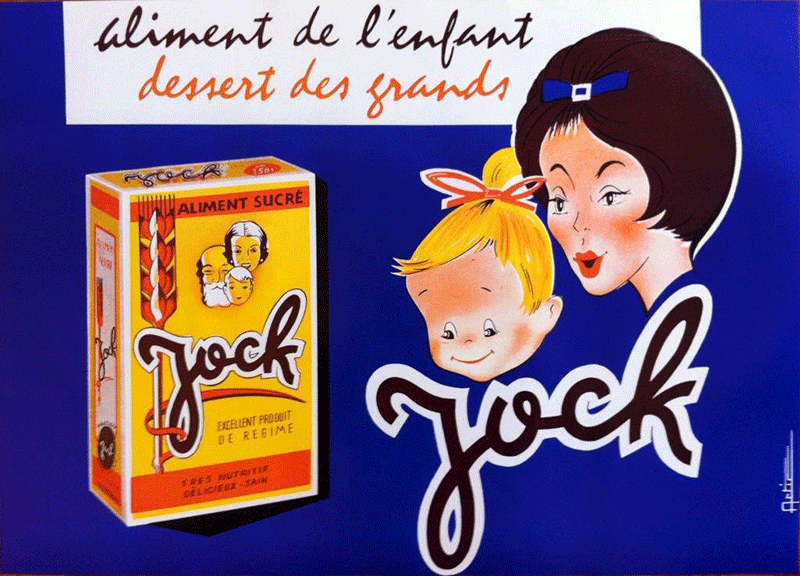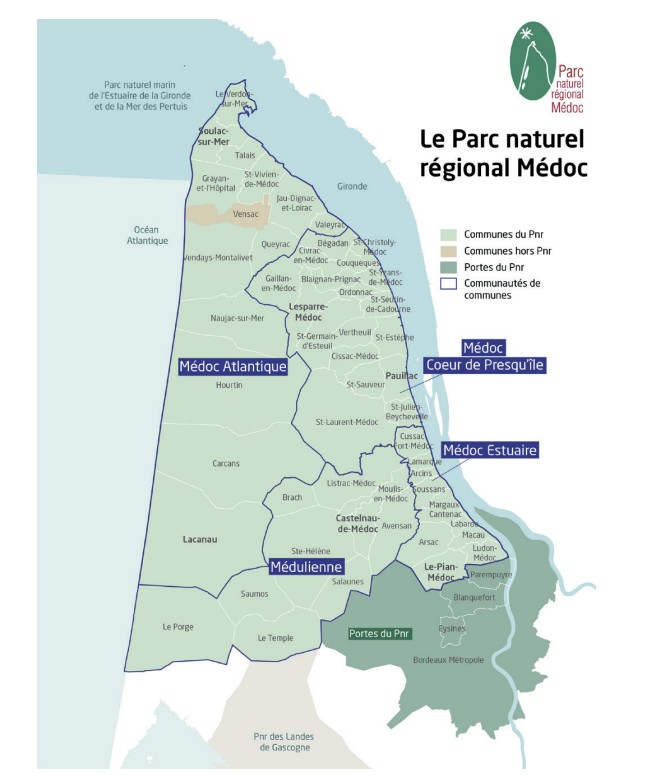[button link= »https://www.francesudouest.com/agenda/ » color= »vertfso »]Agenda[/button]
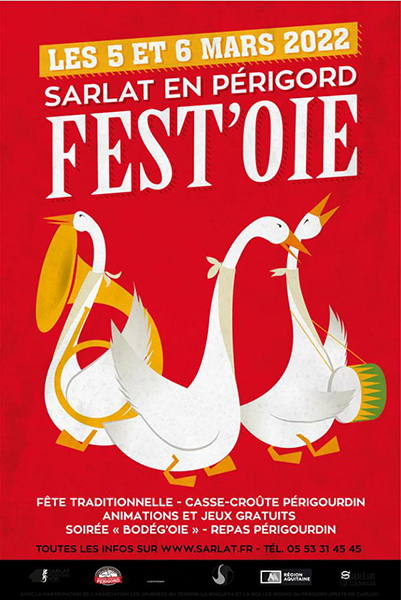
Fête
Du 5 au 6 mars 2022.
Lieu :
Rues de Sarlat.
Contact:
Tél. 05 53 31 45 45
Infos:
www.sarlat-tourisme.com
Horaires:
Le 5 mars 2022 de 15:30 jusqu’à 17:00
Le 6 mars 2022 de 10:30 jusqu’à 12:00 et de 15:00 jusqu’à 16:30
Tarifs :
Plein tarif: 7,50 €
Tarif réduit: 4,50 €
Le 1er week-end de mars, vous allez aimer Sarlat !
Bandas, gastronomie et animations… Ici, on célèbre l’Oie du Périgord sous le signe de la bonne humeur !
Dans la ville de La Boëtie, c’est jour de fête. Les rues s’animent autour de l’oie. Quelle belle aubaine pour déambuler dans ces lieux où l’architecture évolue du Moyen Age jusqu’à nos jours. Venant des cuisines, de bons effluves de mets nous donnent aussi l’occasion d’évoquer la richesse gastronomique de Sarlat et du Périgord Noir.
Programme 2002:
Samedi 5 mars :
14h à 15h30 : Chasse au trésor
Départ Office de tourisme – (Equipe de 6 pers. maximum)
Gratuit sur réservation au 05 53 31 45 45
14h30 et 16h30 : Visites de ferme chez Florian Boucherie à Prats de Carlux.
Florian Boucherie et sa famille vous accueillent dans leur ferme à Prats-de-Carlux : 1h de visite suivie d’une dégustation de leurs produits.
Gratuit, sur réservation au 05 53 31 45 45. Places limitées.
14h30 et 16h30 : Ateliers de cuisine
Boutique » L’Oie aux Pruneaux » Av. Joséphine Baker
Gratuit, sur réservation au 05 53 31 45 45. Places limitées.
14h30 et 16h30 : Visites de ferme et ateliers autour du foie gras à Paulin
Jean-Pierre et Maryline Dubois vous ouvrent les portes de leur ferme à Paulin et vous proposent un atelier pour apprendre à préparer votre foie gras.
Gratuit, sur réservation au 05 53 31 45 45. Places limitées.
15h30 : Visite guidée de la ville
Patrimoine & Gastronomie (7.50 €).
Départ devant l’Office de tourisme, rue Tourny.
15h45 : Visite de ferme à Domme
Chez Alain et Sylvain Germain à la Ferme de Turnac à Domme1. 1h30 de visite avec dégustation de produits de la ferme.
19h : Bodég’oie
Grande soirée festive sur la place de la Liberté animée par 2 bandas. Des assiettes FEST’OIE composées de saucisson, magret séché, rillettes et aiguillettes d’oie et accompagnées des célèbres pommes de terre sarladaises seront servies toute la soirée. Vous retrouverez également des assiettes de fromage, du vin de Bergerac et de la bière locale, servis sous chapiteaux chauffés.
Une soirée à ne pas manquer !
Dimanche 6 mars :
Pour les enfants, des jeux anciens de la Ringueta et des ateliers créatifs sur le thème de l’oie (gratuit) tout au long de la journée
Dès 9h : Marché primé au gras et stands de conserveurs 100% oie du Périgord
Sur la Place de la Liberté.
10h à 12h : Chasse au trésor
Départ Office de tourisme – (Equipe de 6 pers. maximum)
Gratuit sur réservation au 05 53 31 45 45
10h30, 12h30 et 15h : démonstrations de découpe d’oie
sur le parvis de la Mairie, Place de la Liberté
10h30 et 15h30 : Visite guidée de la ville
Patrimoine & Gastronomie (7.50 €).
Départ devant l’Office de tourisme, rue Tourny.
11h : Remise des prix du marché primé au gras
Parvis de la Mairie
A partir de 12h : Casse-croûte périgourdin
Dégustez en famille des assiettes FEST’OIE accompagnées de pommes de terre sarladaises
14h à 15h30 : Chasse au trésor
Départ Office de tourisme – (Equipe de 6 pers. maximum)
Gratuit sur réservation au 05 53 31 45 45